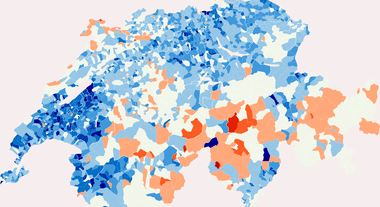Kinshasa, mégapole magnétique
Troisième plus grande ville d’Afrique et première ville francophone du monde, la capitale congolaise est une métropole aussi bouillonnante qu’insaisissable. Malgré l’extrême pauvreté et le manque criant d’infrastructures, des dizaines de milliers de personnes viennent s’y installer chaque année, gonflant des quartiers déjà saturés et cédant aux sirènes d’une ville devenue mythe
Clément Bonnerot (texte) - Herman Kambala et Clément Bonnerot (photos) - Catherine Rüttimann (iconographie) - Simon Petite (montage)
Quand les plus grandes villes du monde seront africaines
En 2050, la population africaine aura doublé et les Africains représenteront un quart de la population mondiale. Une croissance démographique qui sera en grande partie absorbées par les villes du continent. Certaines sont déjà parmi les plus grandes du monde. Comment relever les défis de cette urbanisation fulgurante? Du Maroc à la Tanzanie, en passant par la République démocratique du Congo et la Côte d’Ivoire. Nos journalistes se sont plongés dans quatre villes du continent, retrouvez leurs reportages en cliquant sur la carte.

Le visiteur qui se rend à Kinshasa pour la première fois découvre généralement la ville de nuit, car les vols internationaux atterrissent presque tous tard dans la soirée. En sortant de l’aéroport de Ndjili, il se retrouve immédiatement plongé dans une quasi-obscurité: la seule route qui mène au centre-ville est mal éclairée et les coupures d’électricité sont fréquentes.
Le long du chemin, quelques silhouettes furtives se détachent et s’évanouissent aussitôt qu’elles sont apparues. Çà et là, de petits tas d’ordures en combustion dégagent d’épais voiles de fumée et une lumière rouge qui permet de distinguer les contours de certaines façades aux couleurs délavées. Mais pas le temps de regarder autour de soi: le regard du voyageur est brutalement redirigé vers la chaussée qui, rongée par l’humidité, s’affaisse, et donne naissance à d’immenses cratères que seuls les conducteurs aguerris savent éviter. Au bord de la route, les carcasses de voitures accidentées sont laissées à l’abandon.
Lire aussi: «Donner sa juste place à l'Afrique»
Après une vingtaine de kilomètres, la ville change subitement de visage: les rues s’éclairent, les bâtiments grandissent, les routes s’élargissent. De tous les côtés, des enseignes tapageuses attirent l’œil: restaurants et hôtels de luxe, supermarchés à l’occidentale et bâtiments administratifs se succèdent le long du boulevard du 30-Juin, l’une des principales artères de la capitale congolaise.
Au pied d’un immeuble flambant neuf de dix étages, d’imposantes jeeps aux vitres fumées sont garées sous la surveillance d’une demi-douzaine d’officiers de sécurité aux uniformes élimés. Eponge et seau d’eau à la main, quelques adolescents maigrichons s’activent pour faire briller les voitures tandis que cinq étages plus haut, installés sur la vaste terrasse en teck d’un lounge, leurs propriétaires profitent de la fraîcheur nocturne pour parler affaires en se délectant de mezzé libanais, le tout copieusement arrosé de bière fraîche, de champagne ou de whisky importés d’Europe.


«Kinshasa, c’est un peu comme New York, c’est la ville de tous les possibles», lance Yves Kabongo, le regard pétillant et affichant un large sourire, laissant apparaître des dents du bonheur. Ce jour-là, il est installé sur cette même terrasse du centre-ville, chemise de marque et montre étincelante au poignet: chaque détail de son apparence témoignant avec insolence de sa réussite. A 47 ans, il fait partie de cette génération de «repats» congolais, rentrés au pays pour y investir, après de longues années passées à l’étranger. Né à Kinshasa dans une famille de 12 enfants, il émigre au Canada avec ses parents à l’âge de 18 ans. Il intègre un an plus tard l’Ecole des hautes études commerciales (HEC) de Montréal, grâce à une bourse de la Banque nationale du Canada, qui l’embauche directement après l’obtention de son diplôme. Sa carrière s’envole, il est débauché par Bombardier, le géant canadien de l’aéronautique, s’achète une maison, mène une vie «plus que confortable».
Puis, un jour, il décide de tout plaquer pour retourner en RDC. C’était en 2004. Le pays se relève à peine de deux guerres successives, la première (1996-1997) et la deuxième guerre du Congo (1998 à 2003), qui ont fait plus de 5 millions de morts selon les estimations. L’instabilité politique est à son comble: trois ans plus tôt, le président Laurent-Désiré Kabila est assassiné par son garde du corps à Kinshasa, remplacé par son fils, Joseph, alors âgé de 29 ans. Les investisseurs congolais comme étrangers fuient le pays, mais Yves Kabongo flaire l’opportunité: «C’est du chaos que naît l’ordre, articule-t-il avec assurance, en allumant un cigare. Et comme on dit dans le monde des affaires: no risk, no reward.»
Ici, tout est à construire, c’est la ville de la débrouille. Il faut savoir s’y prendre, mais si vous réussissez à Kinshasa, vous réussirez partout.
«Quand on revient à Kinshasa après des années passées à l’étranger, il faut savoir se réadapter, il faut être patient», poursuit-il. Avec l’aide de son parrain, employé à la MIBA, l’une des plus grandes sociétés minières du pays, il lance un fonds d’investissement, fait faillite trois fois. Les tracasseries du quotidien l’exaspèrent: le retard systématique des employés, les bouchons interminables, les coupures d’eau et d’électricité à répétition. Celles-ci deviendront finalement une source d’inspiration pour son tout dernier projet d’investissement: une centrale hydroélectrique sur le fleuve Congo à 2,7 milliards de dollars (2,45 milliards de francs suisses) pour approvisionner le secteur minier. «S’il n’y avait pas de coupures d’électricité, je n’aurais jamais eu l’idée de construire cette centrale», explique-t-il.
Sur le papier, Kinshasa et la RDC ont tout pour devenir un eldorado. Le pays possède les premières réserves mondiales de coltan, un minerai essentiel pour la fabrication des smartphones. Grâce au fleuve Congo, il pourrait aussi fournir jusqu’à 40% des besoins en électricité de l’Afrique, selon certaines estimations. Malgré tout, la RDC stagne péniblement à la 183e place sur 190 du classement «Doing Business» de la Banque mondiale, qui dénonce d’année en année l’opacité du climat des affaires et la corruption omniprésente. Yves Kabongo en est pourtant convaincu, la mauvaise réputation du pays et en particulier de la capitale congolaise est un problème de storytelling.
Il est presque 18 heures. Sur le boulevard, les taxis jaunes cabossés et les minibus en fin de vie forment des lignes de plus en plus longues, la circulation est presque à l’arrêt. Les esprits s’échauffent, les klaxons fusent. Autour des voitures, une nuée de vendeurs ambulants, les chayeurs, proposent aux conducteurs excédés de «l’eau pure» vendue dans des sachets en plastique. D’autres vendent des drapeaux, des mouchoirs et divers objets empilés sur leurs têtes. Tous espèrent récolter quelques billets avant la tombée de la nuit, pour calmer la faim et regagner ensuite les quartiers périphériques, loin, très loin de l’opulence du centre-ville.
La capitale congolaise est séparée en deux par une frontière invisible aux visiteurs mais gravée dans l’esprit et le vocabulaire de tous les Kinois. D’un côté, la commune de La Gombe, connue simplement sous le nom de «Ville», avec ses villas cossues et ses grands immeubles. Construite de part et d’autre du boulevard du 30-Juin, en bordure du fleuve, c’est l’ancien quartier colonial, aujourd’hui devenu le centre des affaires, là où se concentrent la plupart des institutions du pays, des banques et des grandes entreprises.
Au-delà du célèbre boulevard, c’est la «Cité», chaotique et tentaculaire, avec ses routes défoncées, ses constructions anarchiques et ses rues poussiéreuses, jonchées de déchets. Personne ne sait vraiment combien d’âmes y vivent. De 500 000 au moment de l’indépendance en 1960, on compte désormais à Kinshasa un peu plus de 14 millions d’habitants selon l’ONU. Certains urbanistes parlent de 15, voire 18 millions. Le dernier recensement date de 1984 et, depuis, Kinshasa ne cesse de s’étendre. Ville cosmopolite, on y recense plus de 450 ethnies différentes et presque autant de langues, même si le français et le lingala restent les plus courantes. On y accourt des quatre coins de la RDC, un pays grand comme quatre fois la France, à la recherche d’une vie meilleure. On y vit souvent dans une extrême précarité, à peine 2 dollars par jour en moyenne.
Comme tous les soirs, Samy Ewingi, 26 ans, parcourt à pied la longue piste de sable qui mène jusque chez lui, après une journée éreintante. Avec son frère, sa belle-sœur et leurs deux enfants, ils habitent une maisonnette en parpaing de 30 m2 dans un des nouveaux quartiers de Kinshasa, Sicotra-Local, qui ne figure sur aucune carte. Ici, pas de routes, pas d’eau courante, les coupures d’électricité sont quotidiennes, mais les maisons poussent comme des champignons, malgré la présence d’une ligne à haute tension juste à côté. «Bienvenue chez moi!» lance-t-il d’une voix timide en poussant la porte. A l’intérieur, un simple rideau sépare la chambre du salon. Samy s’installe sur un petit canapé à carreaux rose et mauve dont l’assise est affaissée. Crâne rasé et petit collier de barbe, écharpe turquoise en polaire nouée autour du cou et jean un peu trop large, il reste silencieux plusieurs minutes, balayant du regard les murs dépouillés de la petite pièce.
Ce sont mes parents qui m’avaient encouragé à venir ici. Ils m’avaient dit que j’allais trouver un emploi, que je pourrais m’acheter une maison et qu’ils pourraient ensuite venir s’installer avec moi
Samy a alors tout juste 20 ans et habite Kikwit, dans la province du Kwilu, à 500 kilomètres de Kinshasa. Son diplôme universitaire en poche, il enseigne dans une petite école mais, comme beaucoup de professeurs nouvellement recrutés, il n’est pas payé et survit grâce aux donations des parents, à peine 20 000 francs congolais (10 francs suisses) chaque mois. Alors, en 2014, après seulement quatre mois d’enseignement, il décide de tenter l’aventure, achète un billet de bus, et rejoint son frère, Junior, lui-même établi à Kinshasa depuis 2005.
«Quand j’ai vu sa maison, je me suis dit que mon frère avait réussi», raconte-t-il. Junior, qui exerce comme maçon et gagne entre 50 et 80 dollars par mois, lui prête 100 dollars. Il achète alors des recharges de crédit téléphonique et les vend dans un petit stand de rue. «Je pensais qu’à Kinshasa tout était facile, j’ai découvert une autre réalité», poursuit-il. Il travaille jusqu’à douze heures par jour et, plusieurs fois, des voleurs lui dérobent son stock. Il perd beaucoup d’argent et est rappelé par son père à Kikwit: sa mère est gravement malade. Elle mourra quelques mois plus tard.
Samy retourne finalement à Kinshasa en 2018, pour retenter sa chance. Le jeune homme trouve un emploi dans une école privée qui le paie quelques dollars et travaille à côté comme maraîcher. Au total, il gagne environ 20 dollars américains chaque mois. Le quotidien est compliqué pour lui et sa famille: avec leurs salaires, ils ont à peine de quoi payer le loyer, 30 dollars, l’électricité, 15 dollars par mois, les fournitures scolaires pour les enfants et la nourriture.
A Kinshasa, on accumule sans cesse des dettes. A chaque fois qu’on gagne de l’argent, tout part en quelques heures, car il faut rembourser tous ceux qui nous ont prêté de l’argent
Quand on lui demande s’il ne préférerait pas retourner à Kikwit, où la vie est moins chère, il secoue vigoureusement la tête: «Dans les provinces, il n’y a rien pour les jeunes, il n’y a pas d’emploi.» Ce qui le fait rester? «La télévision», répond-il sans hésiter. Ses yeux s’illuminent: «Je peux avoir faim mais ici, au moins, j’ai de quoi m’occuper.» Ce fan de football et du FC Barcelone explique qu’à Kikwit rares sont les familles qui possèdent un téléviseur: «On ne sait jamais, peut-être qu’un jour je trouverai un travail en regardant la télévision», déclare-t-il avec un large sourire.
Peu importe les galères du quotidien: les nouveaux Kinois ont les yeux qui brillent. Il leur semble que la réussite n’a jamais été aussi proche, même si les richesses qu’ils côtoient leur sont bien souvent inaccessibles, concentrées dans les mains d’une petite minorité. A l’instar des Américains, les Congolais adorent les histoires de réussite fulgurante: comme celle de ce vendeur de rue, «Jimmy En Tout Cas», remarqué il y a trois ans par une chaîne de divertissement grâce à une chanson qu’il chantait sur les marchés pour attirer les passants. Du jour au lendemain, il se retrouve invité sur tous les plateaux télévisés et sa chanson deviendra même le générique d’une émission.

«On se raccroche à des exemples de réussite, ces gens partis de rien», déclare Alesh en sirotant un milkshake dans un café huppé du centre-ville. Le jeune chanteur débarque à Kinshasa en 2010, des rêves plein la tête. Il a 25 ans, a fait ses premières armes dans les salles de concert de Kisangani, la troisième ville du pays, dans le nord-est de la RDC. Son rêve: percer sur la scène kinoise, marcher sur les traces de Koffi Olomide et de Papa Wemba, les grands noms de la musique congolaise.
Dix ans plus tard, il est l’un des rappeurs les plus en vogue du pays: ses chansons cumulent des centaines de milliers de vues sur YouTube et il se produit même en Europe et aux Etats-Unis. «J’ai eu de la chance, confie-t-il, je connais beaucoup d’artistes qui ont abandonné.» Encore aujourd’hui, il peine pourtant à vivre de sa musique: «Je suis obligé d’avoir d’autres activités à côté», explique-t-il. Comme certains musiciens de sa génération, il pourrait aller tenter sa chance à Abidjan ou en Europe, là où l’industrie musicale est plus développée. Mais il ne quitterait Kinshasa pour rien au monde: «Je ne saurais pas faire de la musique ailleurs. Ici, il suffit que j’entende un cri sur un marché, une personne qui parle un peu fort, et je suis inspiré.»
Le clip Biloko Ya Boye («les choses qui arrivent» décrivant les galères du quotidien à Kinshasa) par le rappeur Alesh
C’est un des nombreux paradoxes de Kinshasa. Ville bruyante, polluée et sale, elle repousse autant qu’elle attire, dégage une énergie presque irrésistible. Kinshasa ne laisse jamais indifférent. Ses multiples surnoms en témoignent: «Kin la belle» pour certains, «Kin la poubelle» pour d’autres. Elle est aussi tantôt «Kin Kiese», «Kin la joie», ou «Kin Kiadi», «Kin la tristesse». Dans les années 1960, c’était «Poto Moyindo», «l’Europe noire». Les grands artistes de l’époque, Franco Luambo, Tabu Ley Rochereau ou encore Grand Kallé, les pères de la rumba congolaise, chantent alors les louanges d’une ville qui baigne encore dans l’euphorie de l’indépendance: on y trouverait les meilleurs plats du monde, les plus belles femmes. Kinshasa est la ville de tous les possibles, la ville de l’ambiance où tout Congolais qui se respecte doit avoir mis les pieds au moins une fois dans sa vie. Kinshasa séduit et ensorcelle.
Oh Kinshasa, (ville à) problèmes. Tous les jours, c’est fête après fête, comment faire? Oh ville dont j’avais tant entendu parler. Arrivé ici, mes économies sont parties.
«Ce qui attire les gens à Kinshasa et ce qui les fait rester, c’est tout ce qui a trait au plaisir», analyse Adelin Nsitu, professeur de psychiatrie à l’UNIKIN. Les ultra-riches ont leurs lounges où le champagne coule à flots – la RDC en est d’ailleurs le 4e importateur d'Afrique. Les autres s’entassent dans les nganda, les bars-terrasses traditionnels. On en trouve à tous les coins de rue: il suffit de quelques chaises en plastique et d’une enceinte pour jouer les dernières chansons à la mode. Les plus populaires se trouvent à Bandalungwa, ou tout simplement «Bandal», le quartier de la fête par excellence, ce qui lui vaut d’ailleurs le surnom de «Petit Paris».
«On s’y retrouve pour partager un verre, manger quelques brochettes de viande, explique Adelin Nsitu, mais surtout pour y trouver un peu de chaleur humaine, faire des rencontres. On se sent près de l’autre, on partage avec lui ses émotions, on se sent appartenir à un ensemble.» Un sentiment qui procure aux Kinois une sorte de «sécurité psychologique», surtout pour ceux qui se retrouvent à des centaines, voire des milliers de kilomètres de leur terre natale. Un plaisir momentané, vite consommé et presque aussi vite oublié, mais que l’on cherche à retrouver dès le lendemain: «C’est comme un dopage: les Kinois vivent dans une crise sociale et économique depuis plus de trente ans. Les gens ont besoin de quelque chose pour tenir, même si ce n’est qu’une illusion», conclut le professeur.

Bita Dorcas, elle, n’a pas encore l’âge pour profiter des nganda. Sweat-shirt à capuche bleu et claquettes aux pieds, elle s’installe à contrecœur sur une petite chaise, irritée qu’un mundele, un Blanc, soit venu interrompre la partie de ballon qu’elle disputait avec ses copines. Elle a 12 ans. Originaire d’un petit village du centre du pays, sa mère décède alors qu’elle n’a que 8 ans. Elle est recueillie par une voisine, «Maman Ange», mais la famille de cette dernière ne l’accepte pas. On l’accuse d’être un enfant sorcier et d’avoir provoqué la mort de sa mère. A plusieurs reprises, Bita est menacée d’être tuée ou chassée. Alors, quand «Maman Ange» propose de l’emmener à Kinshasa passer quelques jours, elle saute sur l’occasion.
Tout était beau, tout était grand, j’avais l’impression d’être en Europe
Mais son émerveillement est de courte durée: «Nous marchions toutes les deux, poursuit-elle sans reprendre son souffle, puis je me suis retournée, et je me suis rendu compte que j’étais toute seule.» Elle ne reverra plus jamais «Maman Ange». La petite Bita se met alors à errer dans les rues, fait la connaissance d’autres orphelins, se retrouve obligée de mendier pour manger: «Je n’arrêtais pas de pleurer, je pensais que j’avais atterri en enfer.»
La magie de Kinshasa finit pourtant par opérer. Elle se réfugie dans un bar pour passer la nuit, mais une cliente prend pitié d’elle et accepte de la laisser dormir dans sa cour. Le lendemain, elle la présente à un éducateur, qui la fait venir dans un centre d’accueil pour enfants des rues. Quatre ans plus tard, Bita est toujours là: elle s’est fait des amies, elle étudie. Elle a appris à vivre dans cette ville qu’elle n’a pas choisie: «Kinshasa me va bien, assure la petite fille, en regardant pour la première fois dans les yeux, car je vais à l’école.» Elle sait mieux que personne que l’avenir sera difficile, mais reste optimiste. Quand elle sera plus grande, elle sera médecin: «Il y a beaucoup de monde ici, ça veut dire beaucoup de gens qu’il faut soigner.»
Et puis Bita se lève d’un bond, demande: «C’est fini?», n’attend même pas la réponse, et retourne jouer avec ses amies. A Kinshasa, on préfère ne pas perdre de temps: les moments d’insouciance sont précieux.
Vous aimez nos longs formats?
Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.
Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.
Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!
Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.