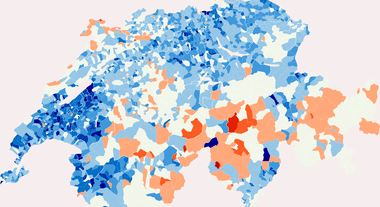Keith Jarrett, les mains du miracle
Le pianiste américain annonçait il y a quelques jours qu’il ne jouerait probablement plus de piano. Il sort un nouvel album live, enregistré en 2016 à Budapest. Prétexte offert à notre journaliste pour raconter sa visite chez lui, dans le New Jersey
- Texte: Arnaud Robert
- Iconographie: Paolo Battiston
- Image d’ouverture: Paolo Woods
- Réalisation Web: Paul Ronga
«Je ne sais pas bien à quoi mon avenir va ressembler. Je n’ai plus l’impression d’être un pianiste. Voilà tout ce que je peux dire.» Le 21 octobre, dans un poignant article du New York Times, le pianiste américain Keith Jarrett annonçait qu’il avait souffert en février puis en mai 2018 d’accidents vasculaires qui l’empêchent désormais de jouer. Tandis que paraît aujourd’hui un nouvel enregistrement de concert solo, gravé en 2016 à Budapest, il ne semble pas superflu de se replonger dans l’une des œuvres décisives de ces 50 dernières années. De son premier récital à 7 ans lorsqu’il jouait Bach, Saint-Saëns et lui-même, jusqu’à ses ultimes apparitions publiques où il soumettait encore à la question cet outil dont il n’est jamais venu à bout, Keith Jarrett est un continent.
Si grand qu’il intimide. Je me souviens de mon effroi lorsque je me suis rendu chez lui, en octobre 2016. Je m’étais glissé dans une invitation qui ne m’avait pas été faite. Quelques mois plus tôt, tandis qu’il préparait un sujet de couverture sur les génies pour le magazine National Geographic, le photographe Paolo Woods m’avait demandé quel musicien répondait à cette étrange définition. Quelques noms s’étaient bousculés dans mon esprit et Keith Jarrett s’était rapidement imposé. S’il existe des génies, Keith Jarrett en est presque l’archétype. D’abord par sa précocité. Il naît le 8 mai 1945, dans une banlieue de Pennsylvanie; dès l’âge de 3 ans, il improvise seul sur le piano droit de son salon, il étudie avec une professeure d’origine russe, qui décèle chez lui une oreille absolue et une propension à la dépasser dès la deuxième leçon.

Keith saisit tout, très vite, et s’agace de la lenteur des autres. Il développe avec le monde une relation de défiance ou d’extrême exigence qui nourrissent une légende de misanthrope. On se souvient de la terreur qu’il instillait parfois lorsqu’il était dérangé par un détail pendant un concert; en 2009, à Zurich, il s’était soudain levé au milieu d’une pièce particulièrement dense et avait demandé: «A quelle distance de la scène se trouve le public?» Comme s’il était heurté par une respiration trop lourde. D’autres fois, on l’a vu vertement tancer un spectateur bronchitique. Les profondeurs auxquelles il aspirait semblaient à la fois dépendre et souffrir de leurs témoins.
Une ferme en forêt
La route qui mène à sa ferme du XVIIIe siècle, enfouie dans les forêts rousses du New Jersey, est barrée de panneaux «propriété privée» et d’un portail électrique. Cet après-midi de 2016, je suis un intrus. J’ai convaincu Paolo Woods de se servir de moi comme petite main, de tenir un lumignon ou de m’activer dans tous les sens pour dresser un décor. L’assistant de Keith Jarrett, qui a servi auparavant auprès de Bruce Springsteen, semble plus nerveux encore que nous. A côté de la demeure du musicien, il y a une espèce de chapelle de bois ocre qui lui sert de studio. On y pénètre après qu’on nous a précisé avec empressement de ne rien toucher – avant de déplacer de cinq centimètres une lampe, l’assistant collera du scotch au sol pour marquer son emplacement exact.

C’est un ermitage. Presque un coffre-fort. Il y a deux grands pianos imbriqués, des orgues, un clavecin, des luths chinois, des percussions indiennes, la photographie de Keith Jarrett jeune, torse nu, sous laquelle il est inscrit en anglais: «Je n’ai pas besoin du soleil pour composer.» Il y a surtout des dizaines et des dizaines d’heures de bandes, des DAT surtout, éparpillées dans tous les coins, le Standards Trio à Montréal en mars 1993, toute la série de concerts du club Blue Note en juin 1994, des VHS des années 1980, une espèce d’inventaire universel des choses jouées. Keith Jarrett enregistre tout et écoute l’essentiel. Il traque ce qui, dans son jeu, ne procède pas de lui. Ainsi il est capable de traiter de son apport, de sa contribution, avec une espèce de franchise qui pourrait passer ailleurs pour de la prétention. Au New York Times, l’autre jour, il expliquait qu’il se sentait comme «le John Coltrane des pianistes»: «Tous ceux qui ont joué du saxophone après lui ont montré à quel point ils lui étaient redevables. Mais il ne s’agissait pas de leur musique. Ils se contentaient de l’imiter.»

Une mystique à l’œuvre
On ne peut pas lui donner tort. La comparaison avec John Coltrane se justifie d’autant plus qu’elle prend également, chez Keith Jarrett, la forme radicale d’une quête mystique. Il semble que la mère du pianiste lui a inculqué jeune cette idée qu’il n’était qu’un canal pour l’expression divine. Jarrett a longtemps été passionné par George Gurdjieff, un philosophe russe né au milieu du XIXe siècle qui mêlait les techniques du moine, du fakir et du yogi pour atteindre le plein potentiel humain. Aujourd’hui, le pianiste est un adepte de la science chrétienne, un mouvement qui croit en la vérité scientifique des guérisons de Jésus et évite de recourir à la médecine moderne.
Depuis ses premières scènes, lorsqu’il débarquait à New York pour rejoindre l’ensemble d’Art Blakey, Keith Jarrett s’est fait remarquer comme une source intarissable d’idées. Le batteur Jack DeJohnette, qui deviendra plus tard un membre permanent de son Standards Trio avec le bassiste Gary Peacock, l’entend un soir. Il est si impressionné par l’engagement physique du soliste, cette façon d’aborder ce lourd instrument en corps-à-corps, ces mouvements de transe qui ressemblent à ceux des orthodoxes juifs en étude, qu’il le conseille au saxophoniste Charles Lloyd. Keith rejoint le groupe, avec lequel il ouvrira en 1967 le Montreux Jazz Festival, et enregistre dans le même élan l’un des disques les plus vendus de l’histoire du jazz: Forest Flowers. Une manière de dérive hallucinogène.

Il est sidérant de revenir aujourd’hui aux premiers engagements de Keith Jarrett lorsqu’il n’était encore qu’un accompagnateur dans une génération si puissante qu’il aurait pu passer inaperçu. Le groupe de Charles Lloyd, bien sûr, mais surtout celui de Miles Davis. Les sessions au club Cellar Door de Washington, en 1970, où Jarrett pratique le clavier électrique Fender Rhodes, contiennent en substance toute l’aventure qui suivra. L’incroyable maîtrise du langage, l’écriture automatique, l’obsession du beau et de sa trahison. Keith Jarrett a beaucoup changé en cinquante ans, son jeu a pris la ferveur mélancolique d’une impossible fin. Mais, de ses dizaines d’albums et de ses projets si différents, chacun pourrait servir de porte d’entrée à l’œuvre entier.
Le «Köln Concert», la «Joconde» du jazz
Alors, ce jour-là, quand il est entré dans la pièce, j’ai pensé à toutes ces marques gravées à même le temps, le premier quartet américain, presque hippie, le souffle de Dewey Redman, le second quartet européen et les glaces tropicales de Jan Garbarek, j’ai pensé à ces milliers d’incunables tournés dans un trio d’académie qui suffiraient à contenir le jazz si tout le jazz était détruit, j’ai pensé à Mozart, au lyrisme rêche d’Arbour Zena, à Bach, à Chostakovitch, à la confrontation d’un être avec les compositeurs classiques, lui qui est défini aux yeux du grand public comme l’incarnation de l’improvisation spontanée et de l’écriture automatique.
Et puis, oui, j’ai pensé aux solos. Le premier pour le label allemand ECM en 1971, Facing You. Celui de Brême et Lausanne (salle de spectacle d’Epalinges, en réalité), 1973. Ceux du Japon, 1976. D’Italie, au milieu des années 1990. Celui de la résurrection, The Melody at Night, with You quand Keith Jarrett émergeait d’une terrible interruption, empêché par une maladie (le syndrome de fatigue chronique) d’autant plus vicieuse qu’elle n’est pas encore assez documentée. Le Testament de 2008, Paris et Londres, après une rupture amoureuse. Et puis, cette chose folle, démesurée, enregistrée à Cologne le 24 janvier 1975.
Si on rend visite au producteur allemand de Keith Jarrett, Manfred Eicher, le fondateur du label ECM, dans ses bureaux qui surplombent justement l’autoroute de Cologne, il vous raconte volontiers cette histoire. La Renault 4L dans laquelle ils traversaient ensemble l’Europe, l’arrivée tardive à Cologne ce soir de 1975, le constat que le piano exigé n’avait pas été livré et qu’il faudrait jouer sur une pétoire. Keith Jarrett est hors de lui, il menace de tout annuler; Eicher le poursuit, le convainc. Dans cette heure et huit minutes de suspension, ces quatre plages dont rien n’était prémédité, il y a la colère et sa transfiguration.
Keith Jarrett a réussi à faire d’une expérience de dérèglement des sens un tube mondial, une fresque intemporelle, très au-delà des cercles consacrés. Presque un espéranto musical. Le Köln Concert rehausse le réel qu’il expose, comme le démontre le long travelling sur vespa du film Journal intime de Nanni Moretti. J’ai tout cela en tête, en octobre 2016, quand le maître pénètre dans son studio et remarque immédiatement la lampe déplacée; il a l’air exaspéré. Le photographe a décidé de montrer le génie reclus dans sa tanière et donc de photographier la maisonnette depuis l’extérieur. Je suis chargé de maintenir Keith Jarrett à son piano.

Alors, pendant une vingtaine de minutes, assis dans un renflement de la pièce, j’écoute Keith Jarrett. Je suis seul et je l’écoute, de ce concert improvisé qui ne m’est pas destiné. Le pianiste semble absolument incapable de faire semblant de jouer pour la caméra au dehors. Alors il entame une première pièce, une sorte de boogie déconstruit, qui dérive très imperceptiblement en swing; j’entends sa voix qui grince, encourage, comme un cocher sa monture. A la fin, il s’exclame: «Ah maintenant je souris. Elle était pas mal, celle-ci. Est-ce que je dois jouer encore?»
Franchement, oui. Je ne me souviens de presque rien qu’il ait dit ce jour-là, même s’il a finalement baissé les armes, mais je me souviens parfaitement de la sensation: Keith Jarrett est capable de s’adresser à l’expérience absolument unique de chacun d’entre nous; son infini savoir et la bataille qu’il mène depuis plus d’un demi-siècle contre le repos, contre un corps défaillant, contre une ère où les stéréotypes sont mieux rétribués que les pensées originales, aboutit à cette certitude qu’il sait saisir le tragique de chaque être.
Budapest, une consolation
Quelques semaines avant que Keith Jarrett nous ait reçus chez lui, il a donné à Budapest un concert qui est l’illustration exacte de ce prodige. C’était au Béla Bartók National Concert Hall, une espèce de navire-cathédrale posé au bord du fleuve. Difficile de savoir s’il s’agissait de cette terre qui l’a inspiré parce que le pianiste a de lointaines origines hongroises ou si c’est la référence à un compositeur qu’il adore, mais, ce soir-là, Keith Jarrett trafiquait avec les anges. De courtes pièces minées, où rôde d’abord une inquiétude électrique, puis des espaces inconquis, des prières qui rassurent, le miracle d’une consolation (Part VII et VIII).
Le concert de Budapest s’achève par Answer Me, un thème qui l’accompagne depuis des décennies, une prière allemande enregistrée par Nat King Cole en 1954 ou Joni Mitchell en 2000. «Answer me», réponds-moi, il y a quelque chose d’enfantin et de déchirant dans cette requête. Au New York Times, Keith Jarrett affirmait qu’il rêve certaines nuits qu’il est encore capable de jouer. Dans le conte de la force et de la fragilité mêlées que constitue l’existence de ce musicien sans précédent, il y a une leçon de résistance.
Pourquoi ce récit?
Dans un moment historique d’incertitude absolue sur les plans sanitaires, économiques, politiques, l’annonce faite par un pianiste de jazz de 75 ans qu’il n’allait plus jouer en public a eu un retentissement qu’on ne pouvait escompter. C’est peut-être parce que Keith Jarret n’est pas seulement un pianiste de jazz. Il est l’incarnation même d’une forme de liberté créative et d’indépendance d’esprit dont le monde a aujourd’hui plus que jamais besoin; il est aussi cet être qui a su toucher, sans voix, des millions de personnes qui n’écoutaient ni musique improvisée ni jazz. Keith Jarrett est un artiste populaire d’élite. Et, au moment où l’idée même de performance publique s’effondre partout, la retraite anticipée d’un géant amplifie la mélancolie de l’époque. Je n’avais jamais raconté cette visite chez Keith Jarrett parce qu’elle n’était pas liée directement à mes fonctions de journaliste. Mais quand j’ai entendu cet homme démesuré évoquer ses limitations nouvelles, j’ai eu en mémoire ces quelques instants privilégiés où la puissance de son esprit, face à un piano au New Jersey, prenait corps.
Vous aimez nos longs formats?
Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.
Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.
Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!
Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.