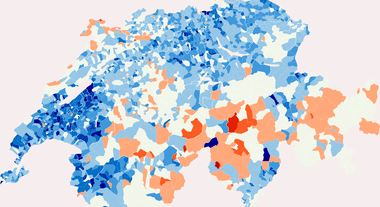Genève au parfum
Comment le bout du lac est devenu la Silicon Valley des odeurs
Genève est une référence mondiale en matière d'arômes et de parfums. Une industrie très discrète, dont Givaudan et Firmenich sont les principaux gardiens. Ces pionniers de la chimie organique attirent dans leur sillage d’autres acteurs clés du secteur
- Reportage: Dejan Nikolic
- Vidéos: X. Lambiel, S. Gabioud et X. Filliez
- Photos: E. Mottaz
- Iconographie: Léa Kloos
Dans la vie, tout a forcément un petit arrière-goût ou une légère odeur de bout du Léman. Boire un Coca-Cola à Dakar, manger une soupe à Manille, faire le ménage chez soi ou se doucher à San Francisco: le moindre geste du quotidien ramène inexorablement à Genève, où siègent notamment Givaudan et Firmenich, les deux plus importants acteurs des arômes et des parfums dans le monde.
«Quel que soit le produit acheté à travers la planète, il y a de fortes chances que sa senteur ou sa saveur contienne au minimum un élément issu de nos laboratoires», résume François-Raphaël Balestra, parfumeur de chez Firmenich. A défaut, l'article renferme au moins un ingrédient provenant des ateliers Givaudan. Le plus souvent, il intègre des constituants originaires des deux multinationales.
Ici sont réalisés les ingrédients d’avant-garde, les innovations les plus compliquées
Dans les années 1920, la région genevoise comptait déjà cinq usines de parfums synthétiques. Elle abrite toujours le site pilote de Firmenich en matière de recherche et de développement. «C’est ici que sont réalisés les ingrédients d’avant-garde, les innovations les plus compliquées, et que sont affinées les recettes. En cas de succès de masse, la production est transférée dans des pays où il est possible de réaliser des tonnages plus importants», explique un technicien des odeurs basé à Genève.
Du Grand Genève (départements de l’Ain, de la Haute-Savoie et Arc lémanique) au Valais, on recense plus de 400 sociétés actives dans le secteur des senteurs et des arômes, pour près de 10 000 emplois. Un écosystème qui comprend des acteurs comme Innovaroma, Mavala, Nucer Diffusion, Robertet, Sunergo, Sunlife, AC&M Parfums, Aarav Fragrances & Flavors, Cosmo International Fragrances...
Un tiers du marché mondial
Et le «hub» du parfum romand continue de se renforcer. Numéro un mondial de la parfumerie de luxe et troisième plus important acteur du secteur de la beauté, le groupe américain Coty vient d’y installer l’un de ses trois principaux sièges commerciaux, ainsi que son pôle international de recherche et développement de fragrances.
VIDÉO. Comme se fabrique une odeur.
De nos jours, toutes les arrière-boutiques des maisons de parfums se vendent entre elles. Pour élaborer ses formules, Firmenich utilise des ingrédients du groupe américain IFF (International Flavors & Fragrances), qui emprunte à Givaudan, lequel puise parfois chez l’Allemand Symrise. Et vice versa. Le protectionnisme, disent les géants du secteur, n’a pas cours parmi eux. Tant que les copyrights sont respectés, dans un marché mondial estimé entre 26 et 32 milliards de francs, dont environ le tiers est actuellement en mains genevoises.
L'arme secrète du carbone
En un peu plus d’un siècle, Genève s’est invité dans les narines et les palais de milliards de consommateurs. Une intimité sensorielle que le canton doit à sa maîtrise de la chimie organique. «A l’époque, personne [ndlr: encore moins Grasse, la capitale traditionnelle du parfum, avec ses champs de fleurs qui couraient à perte de vue] n’aurait pu prédire que les techniques de synthèse allaient prendre une telle importance», relève François-Raphaël Balestra.
Les recherches du groupe familial pour lequel ce dernier travaille permettent aujourd’hui de tromper notre cerveau. Par exemple en neutralisant les émanations fécales des toilettes. Grâce à des technologies de modulation du goût, il imite aussi à la perfection le velouté d’un yogourt sucré, notamment.
Givaudan et Firmenich fabriquent des molécules comme on construit des Lego. Au cœur d’ateliers qui ressemblent à Fort Knox, dans le plus grand secret de leurs cuves, ils marient les atomes, croisent les isotopes, jouent avec les intensités des ions et dopent leurs «jus» – parfum, dans le jargon – à coups de particules inédites. Ces mystérieux élixirs pourront ensuite être vendus à prix d’or.
Les états moléculaires à température ambiante des substances artificielles vont de la poudre aux cristaux, en passant par le beurre, l’huile et autres textures plus ou moins visqueuses. Elles répondent aux doux nom de lilial, ambrofix, javanol, nectaryl, cosmone, rosyfolia, nympheal, helvetolide ou ambrox super, pour n’en citer que quelques-unes.

«C’est la magie du carbone, le matériau de base de toute forme de vie connue», souligne un ex-employé de Givaudan. Une caractéristique de cet élément chimique est l’aptitude qu’ont ses atomes à se lier les uns aux autres, pour former des chaînes moléculaires d’une diversité inouïe. Les techniques employées dans l’élaboration de denrées olfactives de dernière génération font appel à la chromatographie en phase gazeuse ou au spectromètre de masse.
Les scientifiques des odeurs peuvent en reproduire les caractéristiques à volonté, sous des formes synthétiques de plus en plus variées, via une catalyse, des températures très élevées, ou des réactions complexes comme l’hydrogénation ou l’estérification.
L'hédione, du beurre dans les épinards
Les molécules typiques de l’ADN genevois sont nombreuses. Parmi les plus emblématiques, on peut citer l’hédione. Cette découverte issue du jasmin, relativement impopulaire à la fin des années 1950, a longtemps fait les beaux jours de Firmenich. Mis en vedette lors du lancement de l’Eau Sauvage (Dior) en 1966, le composant chimique aujourd’hui très courant ne sent pas grand-chose lorsqu’il est seul. Ce n’est qu’une fois mélangée à d’autres effluves que cette synthèse révèle son potentiel: décupler les senteurs, leur volume, et renforcer la diffusion, sans jamais dénaturer un parfum.
«L’hédione produit un effet comparable au sel en cuisine. Elle agit comme un exhausteur de goût, donnant aux mélanges d’essences un côté épais, capiteux et un peu gustatif, de type floral-fruité», explique un virtuose de la chimie qui officie au bout du Léman. Et un autre intime de Givaudan et de Firmenich de renchérir: «C’est comme ajouter du beurre dans les épinards.»

On dit de l’hédione, l’un des plus grands succès commerciaux du groupe familial genevois, qu’elle a changé le visage de l’industrie. Au point de devenir indispensable à l’élaboration de n’importe quelle fragrance. Brevetée durant les vingt premières années de sa création, cette molécule – copiée mais jamais égalée, selon ses créateurs – était à l’origine proposée à 2000 francs le kilo, contre aujourd’hui environ 9 francs.
Les rois de la parfumerie ménagère
Autre révolution, plus récente: le clearwood, un composant aux notes boisées évoquant le patchouli, lancé en 2014. Née des laboratoires de Firmenich à la Jonction, cette substance est issue de la canne à sucre, selon un processus tiré de la fabrication de la bière, avec des levures que l’on nourrit et qui fermentent. «C’est un ingrédient vert, pionnier dans l’industrie chimique», souligne un scientifique des odeurs, actif dans l’Arc lémanique. Sur le marché, depuis environ dix ans, on observe un retour de la demande pour les produits naturels.
Genève est surtout une plaque tournante mondiale en matière de parfumerie dite ménagère (savons, cosmétiques, lessive, etc.), par opposition à la parfumerie fine, dont la seule fonction est de faire sentir bon la personne qui les porte. Ce segment fonctionnel représente un marché colossal. A elle seule, la marque Ariel utilise jusqu’à 1500 tonnes de fragrances par an. Mais la vente d’ingrédients «de grande cavalerie», écoulés en grandes quantités, n’est pas aussi rentable que ceux destinés à la parfumerie haut de gamme, dont les hubs se concentrent autour des capitales de la mode comme Paris, New York et Milan.

Les budgets de la parfumerie fine sont aussi beaucoup plus importants. «Notre créativité n’est limitée que par les moyens financiers alloués par nos clients. Avec les flacons de luxe, il est possible de s’aventurer dans des territoires olfactifs inédits», confie un compositeur d’odeurs longtemps employé chez Givaudan. Une inventivité de plus en plus nécessaire, car la durée de vie d’un parfum est en effet passée «de sept ans à douze petits mois», signale Jean-Pascal Osmont, cofondateur d’Aroval, un laboratoire de fragrances basé à Genève depuis 2013.
Le bon code olfactif de l’agent lavant
Les parfums sont une arme de séduction des consommateurs. Et cela vaut aussi pour le segment des produits ménagers. «Dans la parfumerie fonctionnelle, l’odeur est l’élément le moins cher d’un produit, mais le plus important, car il conditionne l’acte d’achat et de rachat», signale un expert des senteurs domestiques à Genève. Une lessive sera perçue comme plus performante si elle sent le «propre» qu’une poudre lavant mieux, mais moins bien parfumée.
Un shampoing qui sent la pomme est généralement classé dans la catégorie bon marché en Europe, tandis qu'il peut être vendu comme un produit de luxe à Jakarta
En résumé, un bon shampoing doit sentir le cheveu propre. Et un dentifrice efficace, plutôt la menthe. Rien de logique dans tout cela. L’inconscient régit en grande partie nos préférences olfactives. Le message est d’ordre subliminal. Nos choix de senteurs dépendent de notre vécu et des coutumes locales. «Nous sommes culturellement conditionnés», relève Danielle Buchmann, directrice senior de la conception de fragrances chez Coty à Genève. Le concept de sensualité aux Etats-Unis, un marché féru de parfums capiteux, ne répond pas aux mêmes codes qu’au Japon, où le raffinement se veut radicalement discret.
En Chine, le citron n’est pas associé à la propreté, mais connoté «odeur de poisson». Un shampoing qui sent la pomme est généralement classé dans la catégorie bon marché en Europe, tandis qu'il peut être vendu comme un produit de luxe à Jakarta. Quant au Moyen-Orient, c’est un formidable temple olfactif, au sillage boisé et animal. «En Allemagne, la notion de lavande est très floue. On peut jouer avec, en proposant des notes plus fantaisistes, assez éloignées de la lavande, mais commercialisées comme telle», indique Jean-Pascal Osmont.
La différence entre un bon et un mauvais parfum? Sa personnalité. «Les jus un peu polarisants sont les meilleurs, car ils sont reconnaissables. Et tant pis si l’on ne peut pas plaire à tout le monde», conclut un dirigeant du secteur à Genève.
Pour assaisonner leurs parfums, les marques utilisent des ingrédients rares, dont certains sont prélevés sur des êtres vivants
Les parfums sont vecteurs de messages. Dans la nature, ils servent à attirer, guider, sinon repousser les animaux pollinisateurs ou les partenaires sexuels. Outre les extraits de fleurs, de fruits et autres végétaux, l’industrie a longtemps exploité des matières premières prélevées directement sur des quadrupèdes sauvages. Quitte à les occire.
Le castoréum est une sécrétion sébacée du plus gros rongeur du Canada. Cette substance cireuse-huileuse provient de glandes proches de l’anus et des parties génitales de l’animal. Elle lui sert à imperméabiliser sa fourrure et à marquer son territoire. On en retrouve les attributs – odeur de cuir, de charogne et de feu de cheminée, avec des pointes de prune, d’olive noire et de fruits secs – dans plusieurs flacons, comme Opium d'Yves Saint Laurent, Shanghai Lily de Tom Ford, Arpège de Lanvin ou encore Magie Noire de Lancôme.
Ruée sur le facteur hormonal
Le castoréum est l’une des six composantes animales de la parfumerie fine avec le musc, l’ambre gris, la civette, la cire d’abeille et l’hyraceum, qui est issu d’un mammifère africain. De nos jours, la faune souffre moins des exploitations de jadis, grâce aux techniques de synthèse permettant de reproduire l’équivalent de ces molécules d’origine hormonale.

Firmenich a notamment décroché le Prix Nobel de chimie en 1939 pour ses travaux portant sur le musc artificiel, une très grosse molécule aujourd’hui utilisée partout, de l’assouplissant au flacon chic, et qui donne de la tenue, du corps et de la longévité au parfum. Produit par le bouquetin du Tonkin, il était autrefois très recherché à l’état naturel. Sa fonction primitive? Attirer les femelles grâce un signal olfactif pouvant être capté à plus d’un kilomètre à la ronde.
Vomi ou étron de cétacé
Quel est le point commun entre Obsession for Men de Calvin Klein et Le Mâle de Jean Paul Gaultier, voire Chanel No 5? La civette, obtenue par le curetage de glandes situées sous la queue d’un petit mammifère d’Ethiopie. L’animal sauvage, réputé très agressif, sécrète une pâte molle – beige ou brune – ayant la faculté de sublimer les assemblages les plus précieux.
Autre exemple de mucosité bestiale: l’ambre gris. Cette matière première mystérieuse, dont on aurait trouvé en 1942 un bloc de 340 kilos sur une plage de Madère, dériverait au gré des courants durant de longs mois, avant de s’échouer sur le littoral des océans Indien ou Pacifique. On en trouverait encore parfois des résidus sur quelques rives irlandaises. Il s’agit d’une matière solide, grasse et inflammable, dotée d’une puissance olfactive saisissante, proche de l’odeur d’excréments.
EN VIDÉO. Les vertus de l'ambre gris
Son origine? Le cachalot. Plus exactement l’intestin de l’animal, où se forme une concrétion pathologique provoquée par des calamars dont le cétacé se nourrit, mais qu’il ne digère qu’en partie. A moins que ce ne soient les becs de ses proies qui provoquent des blessures de son tube digestif, jusqu’à entraîner une occlusion intestinale. On suppose que le cachalot, autrefois également chassé pour cette faculté à produire la mystérieuse substance aux propriétés uniques dans le monde vivant, l’expulserait par les voies naturelles.
La parfumerie exploite encore les caractéristiques fragrantes de l’ambre gris par le biais d’infusions, un procédé dont la maison Guerlain est férue. Son créateur en chef de fragrances est un Suisse romand, Thierry Wasser.
Quand le daman du Cap (petit mammifère vivant en Afrique du Sud) urine, il le fait presque toujours au même endroit. Et lorsque tous les membres d’une même colonie vont aux toilettes, cela fait beaucoup de déjections riches en phéromones. Au terme d’un processus de vieillissement relativement long, le contenu de ces latrines à ciel ouvert finit par se cristalliser. On appelle alors l’élément ainsi obtenu l’hyraceum, ou pierre d’Afrique, une matière sombre dont se servent parfois les parfumeurs pour pimenter leurs meilleurs flacons.
 copie_0.jpg?itok=s6kZMUIr)
De nos jours et grâce à la chimie, l’immense majorité des odeurs sont artificielles
La chimie du XIXe siècle a été à la parfumerie ce que le smartphone est aux rapports sociaux. Un élément de rupture. La fragrance de laboratoire a permis l’avènement de molécules synthétiques. Ces dernières ont remplacé les produits d’origine végétale ou animale, jusqu’à représenter aujourd’hui entre 50% et 95% des substances utilisées pour encapsuler des odeurs.
Les avantages des ingrédients artificiels? La maîtrise des coûts de fabrication – plus il y a d’étapes dans la synthèse, plus le prix augmente – et leurs incidences environnementales. Mais aussi la stabilité dans l’approvisionnement, soit une absence de saisonnalité propre aux composants naturels. «La production mondiale de fraises suffirait à peine à couvrir la demande en yogourt à la fraise du marché allemand», expose l’une des têtes pensantes du secteur à Genève.
Un cortège de «néomolécules»
La vanilline de synthèse, copie aromatique du principe actif qui n’est présent que dans 2% de la gousse de vanille, est née de cette révolution organique. Réalisée en 1874, à partir d’un sous-produit de la fabrication du papier, cette «nouvelle» particule gourmande est 300 fois moins chère que sa cousine naturelle, fruit d’une orchidée lianescente tropicale.
La maîtrise du carbone, élément de base de toute forme de vie connue, a permis de repousser les limites de l’industrie en termes de volumes. Elle a aussi enrichi l’éventail des parfumeurs, avec des odeurs jusqu’alors inconnues. Comme la réplique artificielle d’alcool phényléthylique, un composant majeur de la rose. Sa production «in vitro», qui évoque à la fois la jacinthe, le muguet et la pivoine, libère un bouquet qui n'a été découvert à l’état naturel qu'en 1876.
Si l’on compare la parfumerie à la peinture, on peut dire que la synthèse a étoffé la palette de couleurs et de matières disponibles pour réaliser des œuvres d’art olfactives. Les molécules reproduites en laboratoire «offrent de nouveaux effets, de nouvelles dimensions qui démultiplient le champ d’expression des parfumeurs», résume Danielle Buchmann, directrice senior de la conception de fragrances chez Coty, numéro trois mondial du secteur de la beauté. Et son homologue d’une autre grande entreprise du bout du Léman de renchérir: «Aujourd’hui, grâce à la science, la créativité de l’industrie ne connaît presque plus de limites. C’est comme si les parfums étaient passés de la 2D à la 3D.»
Les vieux classiques
Firmenich est leader notamment dans les ingrédients préfabriqués suggérant notamment un univers aquatique. «La calone, par exemple, est une molécule reconstituée qui rappelle l’eau salée. Alors que la cascalone dégage un parfum d’eau de montagne», explique le maître parfumeur Alberto Morillas, à l’origine notamment de CK One de Calvin Klein, de Flower de Kenzo et d’Aqua di Gio de Giorgio Armani, une fragrance inventée il y a plus de deux décennies et qui a su se maintenir dans le top 10 des ventes mondiales.
Si l’art des senteurs est étroitement lié à la chimie, les principaux composants de synthèse utilisés de nos jours avaient déjà été découverts à la fin des années 1930. Dont de nombreux à Genève. On estime aujourd’hui à plus de 4000 le nombre d’ingrédients dont dispose l’industrie pour composer ses fragrances.
Il faut compter entre deux semaines et deux ans pour créer un nouveau parfum. A raison d’un subtil dosage d’une vingtaine à plus de cent ingrédients
Lorsqu’une marque désire lancer un nouveau parfum, ou une nouvelle senteur pour habiller un produit domestique (gel douche, savon, déodorant et autres cosmétiques), elle organise généralement un concours. Ce dernier tient le plus souvent à quelques courtes indications, comme «faites-moi un parfum qui évoque les Galapagos, un soir de pleine lune» ou encore «j’ai besoin d’un jus qui convienne aux femmes actives de 40 ans, mariées et mères de famille, adeptes du shopping régulier». Entrent alors en compétition les «maisons de composition», comme les Genevoises Givaudan et Firmenich, l’Américaine IFF, l’Allemande Symrise, la Japonaise Takasago ou la Française Robertet.
Il faut entre deux semaines et deux ans pour élaborer un parfum, lequel peut contenir de 25 à plus de 100 ingrédients différents. Les compositeurs dans ce domaine sont une espèce rare. Il existerait moins d’un millier de nez dans le monde, dont une petite quarantaine officierait à Genève. «Il paraît que nous sommes moins nombreux que les astronautes», plaisantent les professionnels du secteur.
Les différents dégustateurs d’odeurs
Parmi ces nez, certains ont le statut de maîtres parfumeurs. Un label témoignant du succès exceptionnel de leurs créations. Ils ne seraient pas plus d’une trentaine à porter ce titre dans le monde. Givaudan n’en emploie aucun au bout du Léman, contre environ trois pour Firmenich. Dont Alberto Morillas qui, avec ses quarante-sept années de recherche au compteur et la paternité de plus de 450 parfums sur les plus de 3000 imaginés par le groupe familial genevois, figure parmi les stars de la branche.
Les parfumeurs travaillent en symbiose avec les FDM, pour fragrance developement manager. Ces derniers jouent un rôle de critiques des fragrances. En tant qu’évaluateurs, ils sont le premier avis externe des nez. Ils servent d’interface entre ces derniers et les clients, traduisant le langage marketing des marques en senteurs.
C’est en humant que l’on devient pro
Comment devient-on un nez? A force de sentir, directement en emploi, ou en suivant les cours de l’Isipca (Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire) à Versailles. Givaudan et Firmenich forment à l’interne. La première multinationale dispose toutefois d’une véritable école intra-muros, dans la banlieue parisienne.
Aucune institution ou faculté en Suisse ne propose pour l’heure de filière pour devenir parfumeur. Etonnant, sachant que de tels profils permettent aux entreprises clés du secteur d’engranger des milliards de francs par année. La raison de cette absence est pragmatique. Difficile en effet de rentabiliser un cursus de niche ou de concurrencer la prestigieuse Isipca avec une poignée d’étudiants par semestre

Givaudan et Firmenich détiennent ensemble environ un tiers des parts du marché mondial. Leur rivalité fait rage depuis plus d’un siècle sur les rives du Rhône
Givaudan et Firmenich disent toucher chacun plus de 3 milliards de consommateurs par jour, que ce soit à travers leurs arômes contenus dans notre nourriture ou les odeurs présentes dans nos produits de beauté ou nos détergents. Ce sont respectivement les numéros un et deux de l’industrie des parfums.
Les deux multinationales ont des points communs. Elles sont basées à Genève. Elles ont été fondées en 1895. Mais les similitudes s’arrêtent là. Comme dans toutes les grandes aventures entrepreneuriales, l’histoire de Givaudan et de Firmenich est faite de rivalités. Une tension qui dure bientôt depuis cent vingt ans et se traduit notamment par le fait que leurs employés respectifs ne sont pas censés vivre ensemble. La règle tacite concerne les couples mariés et les partenaires de foyer ou d’oreiller, mais pas les membres d’une même famille comme les frères et sœurs.
Une animosité passagère
En 1947, la synthèse de l’irone, calque artificiel du principe odorant de la racine d’iris, fut éclaircie simultanément par Givaudan et Firmenich. La priorité de cette découverte fut âprement disputée. Le conflit se solda par un compromis. Mais Firmenich eut la «maladresse» – le terme utilisé dans les annales du groupe familial – de dire à Givaudan que son dirigeant risquait la prison. La «profonde blessure» ainsi infligée ne s’effaça que des années plus tard, au terme de plates excuses.
Givaudan et Firmenich répondent à des structures diamétralement opposées. La première, qui n’a pas souhaité nous ouvrir ses portes à Genève, a principalement grandi à coups d’acquisitions. Elle est cotée à la bourse suisse. La seconde, qui revendique une croissance davantage organique, est restée en mains privées, autofinancée à 100%. L’une détrônant l’autre au palmarès des leaders mondiaux de l’industrie au gré de leurs exercices comptables ou par absorptions de concurrents.
Un règne à tour de rôle
Firmenich a toujours été connue pour sa discrétion. Mais en octobre 2006, contrairement à ses habitudes, l’entreprise familiale a diffusé un communiqué triomphant, annonçant qu’elle devenait «numéro un mondial de la parfumerie pour la première fois de son histoire», damant le pion au groupe américain IFF.
Ironie de l’histoire, Givaudan négociait au même moment la perte de cette suprématie. C’est-à-dire le rachat, quelques semaines plus tard, de Quest, le numéro cinq du secteur, pour 2,8 milliards de francs. Alors que la société de Vernier, propriété du groupe bâlois Roche durant trente-sept ans jusqu’en 2000, se hissait du même coup de la troisième à la première marche du podium mondial, Firmenich perdait sa couronne. Mais Genève conservait – et renforçait même – son rôle de plaque tournante planétaire de la maîtrise des odeurs et des saveurs.
Les chiffres clés
Firmenich, qui dit croître annuellement de 7,5% depuis 1989, détiendrait environ 14% des parts du marché mondial, contre près de 20% pour Givaudan. La société familiale de Meyrin-Satigny emploie quelque 7000 salariés à travers le monde, ventilés sur environ 63 sites, dont plus de 30 dédiés à la production. Son rival, qui figure parmi les 30 premières valorisations boursières de Suisse, affiche des effectifs de l’ordre de 8900 collaborateurs, répartis dans un réseau de plus de 80 usines.
Ensemble, Givaudan et Firmenich ont dernièrement dégagé près de 8 milliards de francs de chiffre d’affaires annuel. Les deux entreprises investissent chaque année jusqu’à 10% de leurs ventes dans la recherche et le développement.
L’odeur est un message sensoriel express. Il atteint très rapidement nos zones cérébrales liées à l’émotion et à la mémoire
Comment décrire le Coco de Chanel? Le célèbre parfum appartient à la famille des semi-ambrés fleuris, avec en note de tête la bergamote. Il a pour cœur le jasmin, la rose, la fleur d’oranger et la pêche. Mais, au fond, ce symbole de l’élégance à la française sent le frangipanier, la vanille, l’opopanax et le santal. Petit mode d’emploi pour comprendre l’effeuillage d’une fragrance.
La sensation olfactive est un phénomène complexe. Il serait vain de tenter de décomposer avec précision un assemblage industriel, car il n’existe pas de lien direct entre la chimie d’une odeur et son discernement. Deux molécules structurellement très proches peuvent en effet générer des perceptions fort éloignées.L’odorat est intimement lié au goût. Ce sont deux sens frères: 90% du goût perçu provient de l’odorat. Le message olfactif est par ailleurs une information sensorielle extrêmement rapide, qui passe de l’environnement à notre cerveau, directement dans la mémoire. Jusqu’à atteindre les zones liées à l’émotion.
Le long apprentissage du nez
L’odorat dépend aussi du patrimoine génétique de chaque individu. Nous ne décelons pas tous les mêmes odeurs. Et, dans le cas où nous les détectons, il est souvent difficile pour le profane de les identifier, faute de vocabulaire adéquat. Les parfumeurs s’entraînent toute leur vie à classer les fragrances selon leur famille ou sous-famille olfactive.
Dans le dialecte des nez, on trouve bien sûr les floraux et les boisés (santal, cèdre, vétiver, patchouli…). Mais aussi les hespéridés (zestes d’agrumes, soit la dominante des eaux de Cologne), les fougères (un alliage de géranium, de lavande et de mousse de chêne notamment, à la base de nombreuses eaux de toilette pour hommes) et les orientaux (accords de vanille, de baumes et de résines telles la fève tonka ou la coumarine, avec un rappel de bois, d’épices ou de fleurs). Sans oublier les chyprés ou ambrés (mélange de bergamote, de rose, de jasmin, sur fond boisé et de labdanum), les marins-aquatiques, les verts, les aromatiques et les animaliers, ou encore les cuirs, une catégorie très typée, combinant notamment tabac, miel et bouleau.
Les trois étapes olfactives
Le registre sémantique d’un parfum est aussi fonction des étapes apparaissant lors de son utilisation. Les notes de tête correspondent à ce que l’on sent en premier. Une perception qui peut durer environ deux heures. «C’est l’impression de départ, qui conditionne l’achat, ainsi que le rachat d’un produit. Dans le cas de la parfumerie fonctionnelle, elle sert essentiellement à couvrir la base d’un article ménager, comme la lessive», explique Jean-Pascal Osmont, cofondateur d’Aroval, un laboratoire de fragrances basé à Genève.
EN VIDÉO. Les explication de Jean-Pascal Osmont
Les notes de cœur – jusqu’à quatre heures d’effet – constituent l’identité de la fragrance. «C’est ce que l’on éprouve à l’emploi», souligne notre professionnel indépendant, qui affiche plus de deux décennies d’expertise à son compteur olfactif. Exemple: appliqué sur des cheveux mouillés, un shampoing peut discrètement sentir la verveine ou le mimosa, dégageant progressivement d’autres effluves féminins ou masculins. Alors que versé simplement dans le creux de la main, il exhalera simplement la pomme verte ou le gingembre.
Viennent ensuite les émanations de fond, relatives à la persistance de l’odeur et qui restent sur le cheveu après le rinçage, telle une émotion capillaire. «Avec les notes de fond, on essaie de fixer et faire durer le cœur, explique Jean-Pascal Osmont. S’agissant de la parfumerie fine, c’est l’odeur qui tient à la peau et s’accroche aux vêtements jusqu’à vingt-quatre heures après l’utilisation d’un produit.»
Vous aimez nos longs formats?
Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.
Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.
Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!
Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.





.jpg?itok=2kxXnGje)

-2.jpg.png?itok=1D_ToCmk)