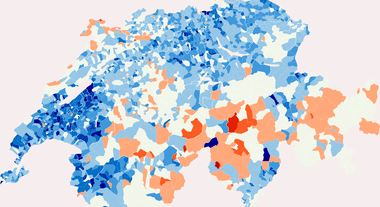.jpg?itok=jL6ZQ8vt)
Les failles d'Aletsch
Le plus grand glacier d'Europe est devenu le laboratoire du réchauffement climatique
Une année après l’accélération brutale des glissements de terrain engendrés par le retrait du glacier d’Aletsch, au moins 18 institutions mènent plus d’une vingtaine de projets sur le site. Reportage dans une réserve naturelle encombrée de scientifiques
- Reportage: Xavier Lambiel
- Photos et vidéos: Xavier Filliez
A quelques mètres des glaces d’Aletsch, elle visse un réflecteur infrarouge sur un mât de métal. Doctorante en géologie à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Franziska Glüer étudie les mouvements de terrain de Moosfluh depuis quatre ans. Au sol, des marquages permettent de mesurer le recul du glacier grâce aux photographies aériennes. Un peu plus loin, d’autres scientifiques installent des capteurs à l’intérieur de puits forés dans la roche, pour étudier les eaux souterraines. Un hélicoptère apparaît et disparaît régulièrement. Elle plisse ses yeux bleus et sourit: «C’est fou comme la fréquentation du site a augmenté depuis une année.»
Vers le 20 septembre 2016, l’affaissement des couches de gneiss qui forment la rive sud du plus grand glacier d’Europe s’est brusquement accéléré. Les mouvements du terrain ont atteint 70 à 80 centimètres par jour, soit des vitesses 400 fois plus rapides que celles qui avaient été observées jusqu’alors. Le retrait rapide du glacier a déstabilisé près de 200 millions de mètres cubes de roche, engendrant des chutes de pierre et des crevasses. Si le risque d’un écroulement soudain semble écarté, des failles spectaculaires sectionnent parfois les sentiers de randonnée, désormais interdits d’accès. Une année plus tard, ce phénomène inédit a ralenti.
.jpg?itok=lifRobiA)
.jpg?itok=puJwbacB)
De son sac de montagne, Franziska Glüer tire les chiffres compilés la veille par ses appareils. Durant les dernières 24 heures, les mouvements de la roche ont oscillé entre 27 centimètres et un millimètre selon les endroits. Concentré de technologie installé sur un rocher qui surplombe les glaces, la «station totale» calcule chaque heure la position de plus de 80 réflecteurs dispersés sur le site. Transmises par un modem alimenté par des panneaux solaires, ces données autorisent un monitoring très précis de ce phénomène inédit, observé pour la première fois vers le début des années 2000 grâce, entre autres, à des données satellitaires.
Effet indirect du réchauffement climatique
La géologue de l’EPFZ étudie les différentes interactions observées entre le glacier et la roche, de 1860 et la fin du «petit âge glaciaire» à nos jours: «Dans le détail, les mécanismes du glissement de terrain de Moosfluh restent assez mystérieux.» Si le recul rapide des glaces explique les mouvements du terrain, Franziska Glüer identifie cinq autres facteurs qui pourraient accélérer le phénomène, parmi lesquels les précipitations, l’érosion, les variations de température, les fluctuations du niveau des eaux souterraines et la «prédisposition naturelle de la roche», dont les différentes couches s’orientent parallèlement au glacier, par foliation.
VIDÉO. Au chevet de la montagne qui s'effrite (3'20)
Partout sur le site apparaissent des roches brillantes, «fraîches», sorties de terre depuis peu, parce que les roches basculent à la façon des livres qui se penchent sur les rayons d’une bibliothèque. Souvent, des marquages jaunes indiquent que ces excroissances font l’objet d’une surveillance. Franziska Glüer s’arrête au bord d’une crevasse impressionnante: «En 2015, cette faille était encore minuscule.» Sur les chemins qui mènent à la station totale où se niche le cœur de son dispositif, elle s’amuse à compter de nombreuses webcams, plusieurs systèmes GPS et quelques géophones. Souvent installés cet été, ces appareils sont parfois distants de quelques mètres seulement.
_0.jpg?itok=rYIeqXkZ)
Ecoles polytechniques, bureaux spécialisés, Etat du Valais, Office fédéral de l’environnement, Universités de Fribourg, Lausanne, Genève ou Grenoble: aujourd’hui, au moins 18 institutions mènent plus d’une vingtaine de projets de surveillance ou de recherche sur le site. Le glissement de terrain se trouve à la fois sur les terres d’une réserve naturelle et sur celles d’un district franc destiné à la régénération du gibier. Cet afflux inédit pose plusieurs problèmes, dont celui des collisions aériennes entre les drones et les hélicoptères. Par ailleurs, la collaboration entre les différents acteurs semble parfois difficile. Cinq organisations différentes ont souhaité installer des appareils d’écoute sismique.
Aletsch est le meilleur endroit au monde pour étudier l’interaction entre les glaciers et leurs vallées
Depuis le printemps dernier, pour éviter les redondances, assurer la sécurité des chercheurs et limiter l’impact sur l’environnement, l’Etat du Valais conditionne la fréquentation du site à une autorisation. Elle oblige les scientifiques à annoncer leurs interventions sur le terrain et à garantir un accès complet aux données récoltées et à leurs interprétations. Le déferlement a été si soudain que le géologue cantonal, Raphaël Mayoraz, n’est pas sûr d’avoir pu répertorier tous les appareils installés avant cette décision: «Nous avons dû intervenir pour canaliser le flux et, à quelques exceptions près, notre procédure a permis de calmer les ardeurs et de conserver le contrôle de la situation.»
INTERACTIF. Utilisez la réglette pour explorer les évolutions du glacier d'Aletsch
Photos: Library of Congress / Keystone
Quand elle a entamé ses recherches, en 2013, Franziska Glüer était souvent seule sur les lieux. Aujourd’hui, quand elle campe dans la région, parfois pour deux mois consécutifs, elle rencontre des randonneurs égarés qui ont ignoré les avertissements et des scientifiques qui n’ont pas toujours sollicité une autorisation: «Pourtant, le site figure au Patrimoine mondial naturel de l’Unesco, et, surtout, l’endroit est dangereux.» La veille, près de la station supérieure des remontées mécaniques, une fillette de 2 ans a chuté dans une crevasse profonde de six mètres et située à l’extérieur du périmètre interdit aux promeneurs. Une centaine de secouristes se sont relayés durant 13 heures pour la sauver
.jpg?itok=GAoZ4vEh)
.jpg?itok=tQr0gmFC)
Docteur en géologie, Simon Löw est à l’origine des différents projets menés par l’EPFZ dans la région depuis 2011 et un premier doctorat qui analysait l’historique du site ces 20 000 dernières années. Il comprend bien l’afflux soudain des scientifiques dans le Haut-Valais: «Aletsch est un site unique parce que les bases de données qui documentent l’évolution du glacier depuis deux siècles sont exceptionnellement précises.» Aujourd’hui, deux de ses chercheurs bénéficient des financements du Fonds national suisse de la recherche scientifique pour travailler sur les pentes de Moosfluh. Un troisième devrait bientôt les rejoindre: «C’est le meilleur endroit au monde pour étudier l’interaction entre les glaciers et leurs vallées.»
Professeur à l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de Genève et spécialiste du changement climatique, Markus Stoffel, né dans le Haut-Valais, est l’un des derniers scientifiques à avoir obtenu l’autorisation de travailler sur le site de Moosfluh. Depuis peu, il mène des analyses dendrochronologiques sur les aroles déracinés de la réserve naturelle d’Aletsch.
Le Temps: Pourquoi vous intéressez-vous au site d’Aletsch, déjà encombré par de nombreux scientifiques?
Markus Stoffel: C’est vrai qu’il y a déjà beaucoup de projets à Moosfluh. C’est un site attrayant, sur lequel tout le monde aimerait faire de la recherche et publier. Mais j’ai grandi dans la région et j’y suis attaché. Et, contrairement à la plupart de mes collègues, je n’étudie pas le glissement de terrain et ses mécanismes, mais les vieux aroles qui s’effondrent sur le glacier. Nous pensons que ces arbres ont entre 600 et 800 ans, et qu’ils contiennent des informations précieuses. Le site est idéal parce que nous pourrons comparer nos relevés paléoclimatiques avec l’histoire du glacier, que nous connaissons très bien.
Qu’espérez-vous découvrir?
Nous souhaitons déterminer les températures et les précipitations passées pour mieux interpréter les avancées et les reculs du glacier à travers les siècles. Si nous parvenons à comprendre ses variations historiques, nous pourrons mieux prédire ses métamorphoses futures. La dendrochronologie étudie les cernes de croissance des arbres et les différences de densité de leurs cellules pour déterminer les fluctuations climatiques qu’ils ont subies. Nous menons aussi des analyses isotopiques qui définissent leur composition moléculaire. L’oxygène et le carbone nous renseignent sur les températures, mais aussi sur les précipitations. La conjugaison de ces approches permettra des reconstitutions climatiques très précises.
Les autorisations ont-elles été difficiles à obtenir?
Habituellement, nous ne pouvons pas mener nos recherches sur des sites protégés. Cette forêt appartient à Pro Natura, qui ne délivre des autorisations que si l’intérêt scientifique l’emporte sur les perturbations engendrées. L’organisation a refusé le prélèvement de rondelles de bois parce que le bruit des tronçonneuses posait problème. En revanche, nous avons obtenu le droit de réaliser des carottages manuels sur les arbres déracinés. Ils laisseront des trous de 15 millimètres de diamètre. Quelque part, nous profitons du glissement de terrain pour échantillonner des spécimens que nous n’aurions pas pu étudier dans d’autres circonstances. Mais j’ai mal au cœur quand je vois disparaître des arbres qui ont résisté à plusieurs siècles.
LA TÉLÉCABINE qui relie Riederalp à Moosfluh survole un gigantesque rocher qui délimite le glissement de terrain. Inaugurée au début de l’hiver 2015, cette installation unique en son genre transporte jusqu’à 13 000 personnes par jour. Elle a coûté 23,5 millions de francs.
Sise à 2300 mètres d’altitude et entièrement enchâssée dans une cuve de béton, la station supérieure a été conçue pour s’adapter aux mouvements du terrain, qu’un système hydraulique permet de compenser. Les six derniers piliers du tracé ont été équipés d’un châssis mobile.
L’infrastructure devait absorber les mouvements de terrain observés au moment de sa conception, soit 40 centimètres par année. Mais quelques mois après la fin du chantier, au printemps 2016, les vitesses de la roche pouvaient atteindre 25 centimètres par jour sur la crête de Moosfluh.
En octobre 2016, les remontées mécaniques ont cessé leurs activités pour réaliser des travaux complémentaires, et remblayer une cavité observée sous la cuve de béton de la station supérieure. C’est à quelques mètres de cette installation qu’une fillette a chuté dans une crevasse la semaine dernière, après s’être éloignée d’un sentier pédestre.
Sur la crête, la roche se déplace désormais d’un peu moins d’un centimètre par jour. C’est toujours plus rapide que les vitesses envisagées lors de la conception de l’installation. La société d’exploitation martèle que la sécurité reste sa priorité absolue. Elle bénéficie toujours d’une autorisation délivrée par l’Office fédéral des transports.
Vous aimez nos longs formats?
Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.
Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.
Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!
Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.