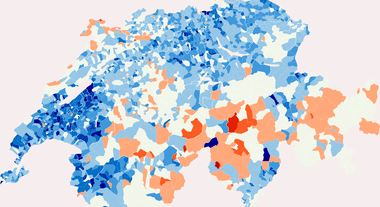Elisabeth II, l'âme du Royaume-Uni
Point focal pour les Britanniques depuis sept décennies, reine durant 16 gouvernements, de 15 premiers ministres différents, et adorée de ses sujets, Elisabeth II a su maintenir la monarchie la plus anachronique au centre de la vie du pays
Texte: Eric Albert, Londres. Photos: EPA/HUGO RITTSON THOMAS/ROYAL HOUSEHOLD; AP Photo/Lefteris Pitarakis; AP Photo; Keystone; AP Photo/Carl Court; AP Photo/Martin Cleaver. Réalisation: Chams Iaz
Que savait-on d’elle? Que pensait-elle? Décédée ce jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth II était le visage le plus connu du monde, l’un des personnages les plus incarnés au cinéma et à la télévision, au profil présent sur les timbres et les souvenirs de mauvais goût. Impossible de manquer ses chapeaux pastel et son sac à main presque vide qu’elle emmenait partout. Mais qu’a-t-elle dit de personnel? Qui étaient ses vrais amis? Que croyait-elle?
La reine est morte, le peuple britannique est en deuil. Pendant sept décennies, elle aura incarné à la perfection l’incontournable socle de stabilité rassemblant le Royaume-Uni, sans jamais rien prononcer de vraiment exceptionnel. Ne rien dire d’intéressant pendant si longtemps est un art, rient les mauvaises langues. C’était au contraire son génie. Tout le monde pouvait projeter sur Elisabeth II ce qu’il souhaitait: sens du devoir, droiture, réserve…

Pour toucher du doigt l’extraordinaire popularité d’Elisabeth II, reine du Royaume-Uni et de 14 autres Etats dans le monde, il fallait se rendre à son jubilé de diamant le 3 juin 2012. Il pleut des cordes sur Londres ce jour-là. Les dizaines de pique-niques de rue organisés dans tout le pays pour le soixantième anniversaire de son règne tombent à l’eau, littéralement. Et pourtant, la foule réagit de la façon la plus anglaise possible: par centaines de milliers, les gens sortent leur parapluie, mettent leurs imperméables et leurs bottes en plastique, et bravent les torrents d’eau qui s’abattent du ciel.
Destination: la Tamise, où une procession de 670 bateaux rend hommage aux 60 années de la souveraine sur le trône. Elle-même est imperturbable, avec ses manteau et chapeau blancs. Mais son attitude importe peu: l’immense majorité de la foule ne peut rien voir. Quelques écrans géants ont bien été placés le long de la rivière, mais il y a trop de monde pour s’en approcher.
Il faut avoir vu ces conditions désastreuses – froid, pluie, foule compacte interdisant toute visibilité – pour mesurer le succès de ce jubilé. La fête est à son comble, les sandwichs aux concombres détrempés mangés avec avidité, la joie réelle. Rien à voir avec de quelconques fous du roi qui campent des jours entiers sur place pour assister aux mariages royaux. Si les médias raffolent de ces derniers, il ne s’agit le plus souvent que d’excentriques bien peu représentatifs. Cette fois-ci, il s’agit bien d’une profonde ferveur populaire.
«Si la monarchie n’existait pas, on perdrait une partie de l’âme de ce pays.»
La meilleure façon de le mesurer est d’aller voir cette pauvre manifestation de républicains juste devant Tower Bridge. Moins de 200 d’entre eux sont présents, avec quelques pancartes faites de bric et de broc. Leur slogan ne relève pas exactement du point de vue révolutionnaire: «La démocratie, pas la monarchie».
Leurs chants sont largement étouffés par le bruit de la foule, leur présence au milieu de l’élan monarchique est pratiquement invisible. Et pourtant, quelle réaction de la part des passants! «Dégagez d’ici!» «Honte à vous!» «Comment osez-vous nous provoquer?» Le flegme anglais démontré quelques instants plus tôt face à la pluie disparaît d’un coup. Les masquent tombent.
Un petit groupe se met spontanément à chanter des refrains monarchiques pour défendre la reine. «Le Royaume-Uni est l’un des pays qui ont conservé leurs traditions et je pense que c’est vraiment important, estime l’un de ces «contre-révolutionnaires». Si la monarchie n’existait pas, on perdrait une partie de l’âme de ce pays.»
Quel destin que celui d’Elisabeth Alexandra Mary Windsor pour en venir à incarner «l’âme d’un pays». Son règne est celui d’une nouvelle ère élisabéthaine, quatre siècles après Elisabeth Ire (1533-1603). Elle a été le souverain le plus longtemps installé sur le trône de l’histoire du Royaume-Uni, ayant dépassé depuis 2015 le record de 23 226 jours de la reine Victoria. Depuis le décès du roi de Thaïlande en 2016, elle était devenue le monarque contemporain au plus long règne à travers le monde.
Elle a été reine de 14 premiers ministres britanniques, du vieux Winston Churchill qui l’avait prise sous son aile au fantasque Boris Johnson, en passant par Margaret Thatcher, avec qui les relations étaient notoirement difficiles. Chaque mardi, la reine les a reçus à Buckingham Palace pour un entretien en tête à tête dont rien n’a jamais fuité.

En ce XXIe siècle, elle a su maintenir d’étonnantes traditions anachroniques. Elle a été cheffe d’Etat du Royaume-Uni et l’était encore de 14 autres pays à la fin de sa vie (Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Belize, Canada, Grenade, Jamaïque, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Iles Salomon, Tuvalu). Elle était gouverneure de l’Eglise d’Angleterre.
Chaque année, elle réalisait l’ouverture du parlement britannique, lisant devant les deux Chambres réunies le programme de «son» gouvernement pour l’année à venir. Elle n’avait bien entendu pas écrit le discours, dont le premier ministre contrôle le contenu, mais c’est bien elle qui le prononçait, avec sur la tête une couronne sortie pour l’occasion de la tour de Londres, arborant son immense traîne, dans un décorum semblant sorti tout droit du Moyen Age.
A sa naissance au 17 Bruton Street, à Londres, le 21 avril 1926 à 2h40 du matin, rien ne la prédestine à cette vie d’exception. Elle n’est que troisième à la succession au trône. La presse britannique ne prête qu’un intérêt réduit à l’arrivée au monde de la princesse Elisabeth. Tout change quand elle a 10 ans. Son oncle, le roi Edouard VIII, abdique, dans un scandale retentissant qui ébranle la couronne. Il voulait épouser Wallis Simpson, qui avait le double inconvénient d’être divorcée et Américaine. Son frère, George VI, le père d’Elisabeth, devient roi. La voilà soudain héritière directe de la couronne britannique.
1940. L’Allemagne nazie a envahi la France et bombarde Londres dans une campagne aérienne d’une rare violence. Seule la Manche protège le Royaume-Uni. La jeune Elisabeth et sa sœur sont envoyées au château de Windsor, en grande banlieue ouest de Londres, où les bombes sont plus rares. La jeune princesse exerce ses premiers devoirs royaux dans cette ambiance lourde. A 14 ans, elle intervient dans une émission de radio de la BBC pour enfants.
«Nous, les enfants, […] faisons tout ce que nous pouvons pour aider nos galants marins, soldats et pilotes. Nous essayons de prendre notre part du fardeau des dangers et de la tristesse de la guerre», annonce-t-elle d’une voix de crécelle, mais dont le débit lent et la diction claire ressemblent déjà à ceux qu’elle emploiera toute sa vie. Cet appel au devoir restera le message constant de son règne, pendant lequel elle s’est finalement peu exprimée. En février 1945, elle rejoint le service auxiliaire territorial des femmes, matricule 230873, apprend la conduite automobile et les rudiments de la mécanique.
Deux ans plus tard, accompagnant ses parents dans un voyage à travers le Commonwealth, elle annonce: «Je déclare devant vous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera dédiée à votre service et au service de la grande famille impériale à laquelle j’appartiens.» Ce sens du devoir, aidé d’une foi chrétienne solidement ancrée, sera sa boussole.
En 1947, la jeune Elisabeth se marie. Le prince Philip de Grèce et du Danemark n’est pourtant pas du goût de sa mère. Il est né en Grèce, a été éduqué en France, avant de finalement venir au Royaume-Uni. Pire encore, il n’a pas de fortune personnelle. Mais il a servi sous les couleurs de l’armée britannique et il accepte des concessions: il renonce à ses titres grecs et danois et se convertit à l’anglicanisme, lui qui était orthodoxe.
Il renonce aussi à son nom de famille allemand pour celui de la branche britannique de sa mère, Mountbatten. Ses sœurs, qui ont épousé des Allemands, sont discrètement absentes de la cérémonie en ce lendemain de Seconde Guerre mondiale. La légende royale préfère insister sur une histoire probablement apocryphe: c’est grâce à des coupons de rationnement supplémentaires que la jeune princesse aurait pu s’acheter sa robe de mariée.
Lire aussi: Décès de Philip, époux d’Elisabeth II: une vie de prince consort malgré lui
Le 6 février 1952, le jeune couple est en voyage officiel à travers le Commonwealth. Depuis une province reculée du Kenya, il apprend le décès de George VI. Elisabeth devient Elisabeth II, Regina. Winston Churchill vient la chercher à la sortie de l’avion. L’Empire britannique existe encore très largement. A 26 ans, elle en est la reine.

Depuis, sa vie est faite de traditions immuables, chaque année égrenant le même calendrier. Elle prend vingt semaines de vacances par an. Le 21 avril, jour de son anniversaire, est la réunion annuelle de l’ordre de la Jarretière. En juin ont lieu les courses hippiques, sa grande passion. L’ouverture du Chelsea Flower Show est également incontournable. Son anniversaire officiel est célébré en juillet, avec Trooping the Colour, la revue des grenadiers de la Garde. L’automne est dominé par la commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale.
Le parcours est millimétré: une partie de la semaine à Buckingham pour le travail officiel, la partie «privée» à Windsor, Noël à Sandringham, sur la côte est, et l’été à Balmoral, en Ecosse, où se sont rassemblés ses quatre enfants et son petit-fils le duc de Cambridge au moment de son décès. A tout cela s’ajoutent les visites officielles des chefs d’Etat, deux fois par an, ainsi que les voyages à l’étranger. En sept décennies, Elisabeth II en a réalisé près de 300, sillonnant la planète – et son royaume – du Canada à l’Australie.
Jamais elle n’émet son avis. L’immense majorité de ses discours sont creux et sans intérêt. Sa seule occasion de s’exprimer est son allocution à Noël, où le message peut être plus ou moins codé, mais se concentre généralement sur un contenu chrétien de charité et d’unité. Cette retenue permanente, ce refus de s’immiscer ouvertement dans les affaires d’Etat, est la clé de son succès. «Réussir à ne pas faire de faux pas pendant des décennies, à ne jamais donner son opinion, c’est en soi une extraordinaire réussite», estime Vernon Bogdanor, spécialiste des affaires monarchiques à l’Université d’Oxford.

Tous les sondages le prouvent. La reine a été l’une des personnalités les plus populaires du Royaume-Uni depuis des décennies. Pour comprendre ce succès, il faut la voir au travail. Prenons, par exemple, une des quatre garden-parties qu’elle donne chaque année à Buckingham Palace.
L’objectif de ces opérations de communication est de flatter l’ego des quelque 25 000 notables invités chaque année: des professeurs d’université, des maires, des dirigeants d’association, des militaires et tous ceux qui se sont distingués d’une manière ou d’une autre… Les portes-fenêtres grandes ouvertes déversent le flot des invités sur l’immense gazon qui s’étale à l’arrière du château. D’un coup, nous sommes à la campagne: 17 hectares de jardin et de forêt, où s’entremêlent châtaigniers, érables et plates-bandes, invisibles de l’extérieur. Ce joyau secret, au cœur de Londres, résume bien la personnalité d’Elisabeth II: une campagnarde qui ne se sent vraiment à l’aise qu’avec ses chiens corgis et ses pur-sang.
Ce joyau secret, au cœur de Londres, résume bien la personnalité d’Elisabeth II: une campagnarde qui ne se sent vraiment à l’aise qu’avec ses chiens corgis et ses pur-sang.
Il est 16h précises: l’orchestre militaire, sous le kiosque, entonne le God Save the Queen. La reine apparaît sur le perron. Une minute plus tard, elle descend sur la pelouse. Discrètement, mais avec une efficacité redoutable, les laquais en chapeau haut de forme et redingote ont tracé un chemin dans la foule, sélectionnant quelques invités qui vont avoir le privilège de parler à la souveraine. Elle entame alors avec eux une vraie discussion qui dure parfois plus de cinq minutes. Le regard droit dans les yeux, elle semble les questionner, les interroger, chercher à comprendre…
Les heureux élus, tout sourire, ressortent de cet échange recouverts de poudre magique, conquis à jamais par Elisabeth II, qui leur a dédié tant de temps. Voilà son vrai travail: la reine est une professionnelle de la réception. Pas au sens frivole du terme, mais parce qu’elle donne à chacun le sentiment profond d’être écouté, sans jamais exprimer elle-même la moindre opinion. Et force est de constater qu’elle y parvient à merveille.
Pendant toutes ces décennies, son seul vrai faux pas est bien entendu Diana. La damoiselle qui semble apeurée lors du mariage de 1981 va se rebiffer contre les tromperies de son mari et futur roi, jusqu’à la séparation publique documentée en détail par les tabloïds. Une annus horribilis, avoue la reine en 1992. La même année, Elisabeth II, sous pression, accepte pour la première fois de payer des impôts.

Cinq ans plus tard, alors que Diana et Charles ont divorcé, la «princesse des cœurs» meurt à Paris dans un accident de voiture, tentant d’échapper aux paparazzis. La reine ne sait comment réagir. Pour elle, Diana ne fait plus partie de la famille et aucune cérémonie officielle n’est nécessaire. Il faudra l’insistance du nouveau premier ministre, Tony Blair, pour qu’elle accepte finalement de baisser le drapeau sur ses châteaux et de revenir à Londres pour témoigner de sa tristesse.
Lire encore: «The Crown», saison 4: Lady Diana et l’envers du décor
Deux décennies plus tard, cet épisode est oublié depuis longtemps. La mémoire de Diana s’efface, tandis que la reine a gagné le cœur de tous les Britanniques. Même les 20% d’entre eux qui se disent républicains l’apprécient, forcés de constater qu’elle a bien fait son travail. Incarnant une sorte de grand-mère de la nation, Elisabeth II a représenté à elle seule une page d’histoire.
Vous aimez nos longs formats?
Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.
Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.
Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!
Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.