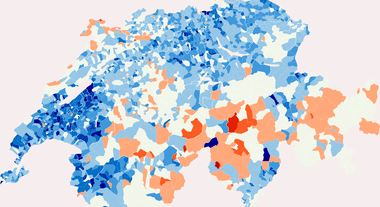Dar es Salaam, l'océan comme seule limite
La capitale économique de la Tanzanie est une des villes qui grandit le plus vite au monde. Elle abritera 10 millions de personnes avant la fin de la décennie alors qu’elle en comptait 1,5 million en 1990. Les urbanistes mettent en garde: c'est le dernier moment pour tenter d'organiser la cité tentaculaire, où de nombreuses communautés vivent en bonne intelligence
Sophie Snelen (textes et photos) - Catherine Rüttimann (iconographie) - Simon Petite (montage)
Quand les plus grandes villes du monde seront africaines
En 2050, la population africaine aura doublé et les Africains représenteront un quart de la population mondiale. Une croissance démographique qui sera en grande partie absorbées par les villes du continent. Certaines sont déjà parmi les plus grandes du monde. Comment relever les défis de cette urbanisation fulgurante? Du Maroc à la Tanzanie, en passant par la République démocratique du Congo et la Côte d’Ivoire. Nos journalistes se sont plongés dans quatre villes du continent et vous livreront leur récit quotidiennement du 28 septembre au 2 octobre. Utilisez la carte ci-contre pour naviguer d'un long format à un autre.

Des marchands agglutinés derrière des stands qui s’étirent sur deux kilomètres, un tourbillon d’échanges de shillings tanzaniens autour de racines de curcuma orangées, de jouets en plastique venus de Chine, de vêtements d’occasion aux marques américaines délavées. Entre les étals, des vendeurs aux charrettes remplies de noix de coco ou de cannes à sucre cherchent péniblement à se faire une place. «Ici, chacun a sa spécialité, c’est comme cela qu’on sait d’où vient une personne», nous crie en swahili Poazi Matata, jeune habitant du quartier, par-dessus les voix des vendeurs à la criée et les sons saturés des haut-parleurs. «Ceux qui vendent des œufs viennent de la région des Grands Lacs, ceux qui proposent du café sont de Dodoma, les cireurs de chaussures du Kilimandjaro.»
Nous sommes sur l’artère principale de Mbagala, un quartier informel, situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie. C’est aussi l’unique route qui mène au sud du pays. «Ce tronçon a été rénové il y a quelques années, avec de larges trottoirs et même une piste cyclable», relève Mejah Mbuya, fondateur de l’association Uwaba, qui promeut la mobilité douce à Dar es Salaam, en nous montrant les balises censées délimiter la chaussée. Sans lui, jamais nous ne les aurions remarquées, tant l’espace a été englouti par les marchands éphémères. Au point que pour avancer les piétons finissent sur la route, au milieu des klaxons des véhicules qui tentent eux aussi de bouger.
«Il y a cinq ans, on aurait encore pu discuter avec les vendeurs de rue pour qu’ils partagent l’espace, mais maintenant qu’ils sont installés, c’est difficile», regrette Mejah. Ce quartier, qui grandit de manière exponentielle, abriterait 1 million de personnes, «peut-être plus», nous dit Poazi.
Quand je suis arrivé ici, je n’avais même pas de lieu où dormir. Maintenant, j’ai ma propre chambre, c’est déjà pas mal
Une chambre est un luxe dans ce pays où un tiers de la population vit à trois ou plus par pièce. Le jeune homme disparaît dans une ruelle parallèle qui descend vers les habitations. Pas de planification, pas de recensement non plus. De là, on prend la mesure: un patchwork de toits en tôles qui s’étalent à perte de vue, des habitations étriquées et construites de manière totalement désordonnée, des ruelles escarpées où seules quelques motos osent s’aventurer. Les urbanistes appellent ce quartier un bidonville. Pourtant, pour qui a vu Kibera à Nairobi ou Khayelitsha près du Cap, Mbagala ressemble plutôt à un village qui n’en finit plus de grandir. Avec ses passages hasardeux qui débouchent sur ce qui pourrait être qualifié de place du village: un arbre, des hommes qui jouent aux dames, un stand de chipsi mayai (frites-œufs), la street food par excellence de Dar es Salaam. L’appel à la prière d’une mosquée éloignée et le terrain sablonneux nous rappellent qu’on est au bord de l’océan Indien. A une trentaine de kilomètres de Zanzibar, une île qui en fait rêver plus d’un.
Ce qui le fait rêver, pour l’heure, Poazi, c’est d’avoir l’eau courante dans son habitation, nous confie-t-il tout en refermant à clé la boîte en métal autour du robinet qu’il partage avec ses voisins – un moyen mis en place par les habitants pour contrôler la consommation de chacun.
Comme la plupart des habitants du quartier de Mbagala, Poazi est un migrant venu de l’arrière-pays tenter sa chance à Dar es Salaam. Issu de Mbeya, petite ville située à 800 km à l’ouest de là, il aurait pu être paysan, comme ses grands-parents. Mais l’agriculture de subsistance ne l’intéresse pas. «Le travail est difficile et il rapporte juste de quoi manger, pas d’argent.» A 16 ans, il quitte donc sa ville natale, avec pour seul diplôme un certificat de fin d’école primaire. Il commence par vendre des cacahuètes au bord de la route avant d’aller proposer ses services au cœur de la cité, à Bongo, «cerveau» en swahili, comme on surnomme aussi la capitale économique. Beaucoup disent qu’il en faut pour pouvoir se débrouiller ici.
Aujourd’hui, il lave des voitures dans le quartier chic des ambassades. Un petit boulot informel qui lui rapporte entre 10 000 et 15 000 shillings tanzaniens par jour (4 à 6 francs). Et tant pis s’il doit passer quatre heures par jour dans des transports bondés pour aller travailler et qu’il paie autant pour se déplacer que pour se loger. «Au moins ici l’argent circule et on peut se faire un pourboire, ce qui n’est pas le cas à Mbeya.»



Attirés par des opportunités économiques plus abondantes et diversifiées que dans le reste du pays, les migrants sont toujours plus nombreux à converger vers la métropole. Ajoutez à cela un nombre élevé de naissances, 5,2 enfants par femme en moyenne, et voilà Dar es Salaam projetée à la deuxième place mondiale des villes dont la population grandit le plus rapidement, juste derrière Suzhou, dans la province de Jiangsu, en Chine. Un taux de croissance de 5,4% par an, contre 4% pour la moyenne de l’Afrique subsaharienne. A ce rythme-là, elle atteindra 10,8 millions d’habitants en 2030 et décrochera son titre de mégapole. Un chiffre qui pourrait encore doubler d’ici à 2050.
L'expansion de la ville est sans précédent dans le monde. Le rythme de croissance est tellement rapide que ça rendrait le travail presque impossible pour n’importe quel gouvernement
Une croissance horizontale qui, passé un seuil, rend tout développement d’infrastructures plus cher et plus compliqué. Selon Wilbard Kombe, professeur en gestion des territoires urbains à l’Université Ardhi de Dar es Salaam, «plus la densification est importante, moins il est possible d’intervenir sans détruire ce que la population locale a mis en place. On parle donc d’une fenêtre d’opportunité entre le formel et l’informel qui se referme à mesure que la densité se renforce.» Manque de moyens financiers, manque de volonté politique aussi. Selon Mary Grace, «pour la municipalité de Temeke par exemple (dont Mbagala fait partie), il y a moins de dix personnes chargées de la planification urbaine. Le processus formel est tellement long et tellement coûteux que construire de manière informelle est devenu la norme.»
A Dar es Salaam, 70% des logements sont construits sans planification et 80% des emplois le sont dans le secteur informel. Un secteur ni complètement illégal, ni tout à fait contrôlé, une zone grise dans laquelle les autorités et la population tentent de trouver des arrangements. «Avec plus ou moins de résultats», ajoute Mejah, alors que nous longeons un imposant bâtiment jaune à la peinture décrépite. Conçu il y a quinze ans pour regrouper tous les vendeurs de rue dans un même lieu, il est aujourd’hui à l’abandon.
Ici, on ne va pas au supermarché pour faire ses courses, on fait ses achats dans la rue, sur le chemin du travail
Les clients ne sont jamais venus et les vendeurs sont retournés dans la rue. Aujourd’hui, en échange de 20 000 shillings tanzaniens par an, l’équivalent d’une vingtaine de noix de coco vendues, ils reçoivent une carte leur permettant d’exercer leur activité en toute légalité. Une manière de régulariser l’informel, «ou tout simplement de nous taxer», s’emporte Josephat Leshora, en nous montrant la facture de son impôt foncier.
Arrivé à Dar es Salaam en 1985, ce quinquagénaire et père de six enfants fait partie des premiers «migrants urbains» à avoir acheté un terrain à Tandale – alors petit village au bord de la rivière Mbokomu – aujourd’hui surpeuplé. Sur le devant de sa maison, qu’il a mis quinze ans à construire, trône désormais une plaque dorée avec un numéro de référence. Officiellement donc sa maison est répertoriée, mais il n’a toujours pas de titre de propriété.
«Ce programme de régularisation et de formalisation des habitations non planifiées a été lancé dans le but de réduire la densification et d’augmenter la propriété foncière. Mais dix ans plus tard, seules 100 000 personnes ont acquis un titre de propriété», explique Priscila Izar, chercheuse à l’Université Ardhi et directrice de CityLab à Dar es Salaam, un centre de recherche sur l’urbanisation.
Les quartiers tentaculaires comme Mbagala ou Tandale se propagent tout autour de la ville. Seul l’océan, à l’est, semble pouvoir contenir cet étalement. Depuis la mer justement, Dar es Salaam offre pourtant un tout autre visage, avec ses tours jumelles en verre flambant neuves qui lui donnent des airs de mini-Dubaï. Pour Priscila Izar, «il n’y a pas un seul, mais plusieurs processus d’urbanisation simultanés. D’un côté, un étalement de la ville vers la périphérie et de l’autre des énormes projets d’infrastructures et des investissements immobiliers dans le centre-ville, pour générer des revenus publics».
Au pied des immenses tours à moitié vides, un flot de travailleurs journaliers qui commutent à bord d’un ferry permettant de relier le quartier de Kigamboni, séparé par un bras de mer, au cœur de la cité. Il y a encore quatre ans, ces pendulaires se seraient précipités de manière chaotique pour tenter de monter dans un des 7500 daladalas que compte la ville, des minibus aux horaires fantaisistes gérés par des particuliers.
Aujourd’hui, cette marée humaine se dirige comme un seul homme vers la station des bus bleus chinois, les BRT, Bus Rapid Transit, un réseau de liaisons rapides par autobus, avec une voie réservée, comparable à un métro. Un système de transport en commun qui fait figure de précurseur en Afrique. «Tout le continent a les yeux tournés vers Dar es Salaam pour copier ce modèle», nous dit une spécialiste des transports urbains à la Banque mondiale, laquelle finance en bonne partie ce projet.
Un système qui a valu à Dar es Salaam d’être la première ville africaine à gagner, en 2018, le Prix mondial du transport durable de l’ITDP, lnstitute for Transportation and Development Policy, une organisation américaine qui promeut les politiques de transports durables.


Pour Rachel Kayeye, pendulaire, c’est surtout un gain de temps. Alors qu’elle mettait chaque jour une heure et demie pour aller au travail à bord des daladalas, le même trajet lui prend huit minutes avec les bus rapides «enfin, quand il y en a un», rajoute-t-elle. Car sur la centaine de véhicules initialement prévue, la moitié a été endommagée à la suite des inondations successives survenues dans les entrepôts de Jangwani, une zone en cuvette en contrebas de la rivière Msimbazi. «Cette région est connue depuis longtemps pour être submergée par les eaux pendant la saison des pluies, nous dit Rachel, je ne comprends pas pourquoi ils ont construit les dépôts de bus ici.» Même si c’est à demi-mot, un certain ras-le-bol se fait sentir, un mois avant les élections présidentielles et législatives, prévues le 28 octobre.
En campagne pour sa réélection, le président John Magufuli, aussi surnommé «le Bulldozer», a fait des gros projets d’infrastructures sa priorité. Il s’est attelé, entre autres, à un gigantesque réseau ferroviaire, qui devrait à terme relier Dar es Salaam au Rwanda, en passant par Dodoma. Dodoma, la capitale politique de la Tanzanie, comme l’a voulu le premier président du pays, Julius Nyerere, en 1974. Dodoma qui, dans les faits, est restée une petite bourgade au centre du pays pendant plus de quarante ans. Jusqu’à ce que Magufuli arrive et y transfère ses ministères. Reflet de la volonté de l’actuel président, comme Nyerere avant lui, de prioriser le développement en dehors de Dar es Salaam. Selon Priscila Izar, «le gouvernement, très top-down, en se focalisant d’abord sur des projets d’infrastructures à grande échelle, oublie en quelque sorte la grande majorité des gens, que de petites améliorations suffiraient à aider pendant des décennies.»
Très applaudi au début de son mandat parce qu’il a fait de la lutte contre la corruption et le gaspillage de l’argent public sa priorité, sa ligne dure contre la liberté d’expression lui vaut aujourd’hui des critiques. Si la Tanzanie a sensiblement progressé sur l’indice de perception de la corruption de Transparency International, principal indicateur mondial de la corruption dans le secteur public, au même moment, le pays dégringolait au classement de Reporters sans frontières. Selon l’organisation, «aucun des 180 pays classés par RSF n’a connu une telle dégradation de sa situation en matière de liberté de la presse au cours de ces dernières années.»
Une dégradation qui se ressent jusque dans la rue. «On est infectés par la peur», nous lance Mejah. Alors on ne parle pas de politique, on ne parle pas du «virus» non plus. De toute façon, il n’y en a pas, le président a publiquement annoncé la fin de la pandémie le 8 juin déjà. Avant cela, il s’était fait remarquer pour ses propos chocs demandant à la population d’aller prier. Les mosquées et les églises n’ont jamais fermé.
Le virus ne peut pas vivre dans le corps du Christ
Les chiffres ont arrêté d’être publiés en avril. Officiellement il y a donc eu 21 morts pour plus de 60 millions d’habitants. Une stratégie pour ne pas inquiéter la population? Une ruse préélectorale? Un choix, aussi, de privilégier avant tout l’économie. Si le 16 mars, à l’annonce du premier cas, toutes les écoles du pays ont fermé avec effet immédiat – pour ne rouvrir qu’en juillet – et que les vols internationaux ont été stoppés, la Tanzanie n’a jamais imposé de confinement, contrairement à la plupart des pays de la région. Pour Poazi, comme pour la grande majorité de la population qui gagne sa vie au jour le jour, ne pas sortir, c’est ne pas vivre. «Si je ne lave pas de voiture, je ne gagne rien, je ne mange pas et donc je meurs bien avant d’être infecté.»
Dar es Salaam – havre de paix en arabe. Voici ce qu’un petit village de 400 pêcheurs inspira au sultan omanais Majid de Zanzibar dans les années 1860, quand il décida d’en faire sa base arrière, pour renforcer son archipel voisin, alors plaque tournante du commerce d’esclaves et d’ivoire de l’océan Indien. Un siècle et demi après, son harmonie n’a pas été ébranlée. Contrairement à ses homologues de la région – Kampala, Bujumbura, Kigali, Nairobi –, Dar es Salaam n’a connu ni guerre civile ni violentes manifestations depuis l’indépendance de la Tanzanie en 1961. Seule ombre au tableau: l’attaque terroriste contre l’ambassade des Etats-Unis par des militants islamiques en 1998, au cours de laquelle dix Tanzaniens ont été tués et de nombreux autres blessés. Malgré une urbanisation parmi les plus rapides du monde, ni les origines ethniques ni la religion ne sont des sujets de tensions dans la mégapole en devenir. Faute de recensement récent, tout le monde s’accorde à dire qu’il y a une proportion plus ou moins équivalente de musulmans et de chrétiens. Et contrairement à d’autres grandes villes africaines, aucun groupe ethnique – le pays en compte une centaine – n’a jamais pris d’ascendant au point d’en dominer un autre.
Multiethnique, multireligieuse, Dar es Salaam s’est construite dans la pluralité. D’abord point d’échange privilégié avec les commerçants d’Asie et du golfe Persique portés par les alizés, elle a gardé l’islam et la langue swahilie, une langue bantoue enrichie de mots arabes, qui s’est diffusée à l’intérieur des terres via les caravanes, parlée aujourd’hui par tous les Tanzaniens. Sous contrôle allemand puis britannique, Dar es Salaam accueille des populations de l’intérieur des terres, fraîchement christianisées ainsi que des Indiens, à la fois hindous et musulmans, considérés comme main-d’œuvre qualifiée par les colons britanniques.


Aujourd’hui à Dar es Salaam, le quartier indien, surnommé Uhindini, avec son regroupement de temples et de mosquées, est la seule partie de la ville où une certaine distinction ethnique subsiste, la plupart des habitants étant toujours des Indiens d’origine. Quand, dans les années 1950, le pays connaît ses premiers mouvements de lutte pour l’indépendance, c’est à Dar es Salaam que chrétiens et musulmans se rassemblent pour fonder le premier parti politique non religieux, le TANU (Tanganyika African National Union), et que ses membres – majoritairement musulmans – élisent à sa tête un chrétien, Julius Nyerere, qui deviendra le premier président du pays indépendant. C’est à Dar es Salaam aussi que convergent les militants des mouvements indépendantistes et les défenseurs des droits de la communauté noire – Nelson Mandela, Che Guevara, Malcolm X, tous sont passés par là, attirés par l’idéal socialiste de Julius Nyerere.
Baba wa Taifa, père de la nation, comme les Tanzaniens l’appellent, a sans conteste joué un rôle prédominant dans l’harmonie qui subsiste aujourd’hui à Dar es Salaam et dans tout le pays. Défendant une philosophie basée sur l’égalité, Julius Nyerere a supprimé tout élément ethnique ou religieux de la politique nationale tout en continuant à entretenir de bonnes relations avec les différents représentants religieux – parfois consultés sur certaines décisions. Si son programme Ujamaa, d’influence maoïste, de créer de grands villages communautaires alliant productivité et partage des ressources du pays a été un désastre sur le plan économique, le sentiment d’identité nationale dans la diversité a subsisté. Aujourd’hui, les citoyens se considèrent d’abord comme Tanzaniens plutôt que comme chrétiens, musulmans ou appartenant à un certain groupe ethnique. Pour autant, ils respectent la religion de chacun. D’ailleurs, la plupart des réunions commencent par des prières à la fois musulmanes et chrétiennes. Et depuis son indépendance, la présidence du pays a été alternée entre les deux grandes religions.
Forte de ces idéaux égalitaires et de ces influences hétéroclites, Dar es Salaam se construit en mégapole pacifique. Malgré la surpopulation de ses périphéries, malgré le remplacement de certains de ses bâtiments d’héritage arabo-germano-britannique par des tours en verre, bien qu’elle ait été détrônée de son titre de capitale politique, Dar es Salaam reste une ville paisible. Où l’on continue de converger.
Vous aimez nos longs formats?
Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.
Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.
Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!
Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.