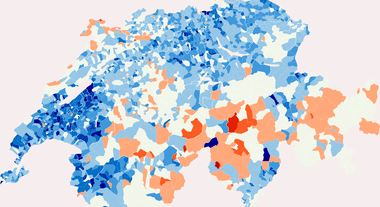Au Brassus, où s’écrit la complication horlogère d’hier et de demain
Un reportage de Hélène Haguenauer.
On le sait peu mais jusqu’au début des années 1950, Audemars Piguet n’employait qu’une trentaine de personnes et ne produisait que des pièces uniques. Comment le petit atelier du Brassus fondé en 1875 est-il devenu la grande marque que l’on connaît aujourd’hui? A force d’audace et de ténacité, la manufacture familiale a su se démarquer par sa spécialisation dans le domaine des complications horlogères. Une culture propre à la vallée de Joux, qui s’exprime aujourd’hui encore à travers une myriade d’innovations techniques qui éclairent le présent à la lumière du passé.
Texte: Hélène Haguenauer - Photos fournies par Audemars Piguet
A observer l’alignement des plus prestigieuses manufactures horlogères enracinées à flanc de colline, entre la voie ferrée, la petite route et les prairies, on peine à imaginer qu’il fut un temps où l’austérité l’emportait ici largement sur la prospérité. Il faut tirer les fils de l’histoire et plonger dans l’immensité des archives horlogères pour remonter à cette époque où les anciens disaient de la vallée de Joux qu’«il n’y pousse que des cailloux». Enclavés, retirés sur eux-mêmes, particulièrement à la faveur des frimas de l’hiver, les ruraux du XVIIIe siècle ignoraient combien leurs conditions de vie difficiles constitueraient un terreau fertile au développement d’une spécialité régionale d’excellence aujourd’hui reconnue partout dans le monde. Dans leurs mains, de fabuleuses montres à sonnerie, des quantièmes perpétuels, des tourbillons ou des chronographes doués d’une performance chronométrique hors pair y ont vu le jour, imposant la vallée de Joux comme l’un des berceaux des complications horlogères.

C’est dans le petit village du Brassus que les fondateurs d’Audemars Piguet ont posé les jalons d’une culture de la complication horlogère qui, depuis 1875, nourrit plusieurs générations d’artisans au sein de la manufacture familiale. Audacieux, entrepreneurs dans l’âme, Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet appartiennent à ce terroir d’horlogers capables d’élaborer des chefs-d’œuvre mécaniques d’une grande technicité. La plupart des artisans qui se sont distingués à leur époque n’ont laissé aucune trace; même les plus célèbres ne sont connus que d’un cercle restreint de connaisseurs ou de collectionneurs, sans doute parce qu’ils ont longtemps œuvré en coulisse pour le compte d’autres maisons, telles Leroy à Paris, Dent à Londres ou Patek Philippe à Genève.

Ce modèle de production que les historiens qualifient d’«établissage» explique certainement pourquoi la spécialité des complications horlogères a pu prospérer dans cette vallée retirée, comme nulle part ailleurs. Certains fabriquaient des ébauches de mécanismes horlogers. D’autres excellaient dans la fabrication des ressorts, des cadratures, des échappements ou des boîtiers de montres. Quelques artisans occupaient leurs journées à produire des pignons ou des timbres pour les montres à sonnerie. Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet tenaient quant à eux un rôle tout aussi spécifique mais bien différent, celui d’«établisseurs».
«Dans leurs ateliers, les horlogers repasseurs terminaient les mouvements à complications et les emboîtaient, expliquent Sébastian Vivas, directeur du musée et du patrimoine d’Audemars Piguet, et l’historien et responsable des complications Michael Friedman dans l’introduction de l’ouvrage Les montres-bracelets à complications Audemars Piguet au XXe siècle.
![La [Re]Master01 Chronographe Automatique, sortie cette année, réinterprète une des rares montres-bracelets chronographes de 1943.](/sites/default/files/styles/lt_longread/public/2020-10/26595sr_oo_a032ve_01_closeup_gp17_jpeg.jpeg?itok=Nd1Ja3Jg)

L’établisseur orchestrait le travail de plusieurs dizaines de petits ateliers, souvent à domicile. Cette structure composée d’une myriade d’entités interdépendantes, chacune dans les mains d’une famille, explique notamment le fait que, pendant la plus grande partie de l’histoire d’Audemars Piguet, les volumes de production sont restés extrêmement limités, dépassant rarement quelques centaines de montres par an.» Aussi étonnant que cela puisse paraître quand on sait la force de frappe dont elle fait preuve aujourd’hui, la manufacture n’a occupé qu’entre 10 et 30 artisans jusque dans les années 1950. La notion de modèle de montre n’existait pas. Celle de collection encore moins, les créations étant produites en pièces uniques.
«En 1972, une nouvelle ère s’est ouverte avec la création d’un modèle à l’esthétique hors norme: l’iconoclaste Royal Oak, suivie en 1993 de la Royal Oak Offshore. Radicales et novatrices, ces deux collections ont si fortement marqué l’histoire récente de la marque qu’elles ont en partie oblitéré le siècle qui les a précédées. Au point de faire oublier qu’elles y puisent leurs origines mécaniques et esthétiques», expliquent Sébastian Vivas et Michael Friedman. Bien longtemps avant le succès phénoménal de ces collections qui ont contribué à propulser Audemars Piguet sur le devant de la scène horlogère, les artisans de la manufacture familiale du Brassus ont appris à maîtriser les complications horlogères classiques. Ainsi, durant les deux premières décennies suivant la création de la marque en 1875, près de trois quarts des montres de poche qui sortaient des ateliers étaient dotées d’au moins une complication. Plus de la moitié offrait un mécanisme de sonnerie.
La miniaturisation de ces calibres a permis l’émergence des premières montres-bracelets à complications. En 1892, la manufacture crée en collaboration avec Louis Brandt & Frère (future Omega) la première montre-bracelet à répétition minutes de l’histoire. Le livre précité détaille également l’arrivée des montres-bracelets à calendrier dès 1924, puis des chronographes en 1930 et des doubles complications dès 1942.

Et, malgré les crises économiques, les guerres, les années noires ou les ravages du quartz, les horlogers de la vallée de Joux n’ont jamais tout à fait abandonné la spécialité des complications horlogères. Elles ont contribué à la renaissance de l’horlogerie traditionnelle chez Audemars Piguet à partir de 1978. Cette année-là, l’une des plus noires de la crise du quartz, la manufacture présente le calendrier perpétuel automatique le plus plat du monde. Instantané, son succès démontre que l’horlogerie traditionnelle à complications a encore un bel avenir.

Aujourd’hui plus que jamais, les complications classiques constituent une source d’inspiration pour la création des collections contemporaines de la manufacture, comme en témoignent les nouvelles déclinaisons de la Code 11.59 by Audemars Piguet dévoilées cet automne.
«L’analogie entre la nouvelle Code 11.59 by Audemars Piguet Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie et nos montres à sonnerie créées depuis la naissance d’Audemars Piguet est assez évidente», souligne Sébastian Vivas. Les archives confirment que plus de la moitié des 1625 montres produites au Brassus entre 1882 et 1892 incluaient un mécanisme à sonnerie. Considérée comme l’une des complications horlogères les plus complexes et les plus sophistiquées, la Grande Sonnerie était pourtant rare puisque seulement 28 pièces ont été produites durant la même période. Et pour cause: «La Grande Sonnerie est l’apogée des montres à sonnerie, explique Lucas Raggi, directeur du développement chez Audemars Piguet. Tel un orchestre, la synchronisation des composants doit être absolument parfaite afin de garantir la sonnerie automatique des heures et des quarts.»
Il faudra donc attendre 1994 pour que la marque dévoile sa première montre-bracelet dotée d’un mécanisme Grande Sonnerie. Aujourd’hui encore, seulement une poignée d’horlogers sont capables de restaurer ces petites merveilles de miniaturisation dont le calibre mesure seulement 28,6 mm de diamètre et 5,2 mm d’épaisseur.
Les cadrans de la trilogie réalisée par Anita Porchet conjuguent savoir-faire ancestral et design contemporain.
Au cœur de la nouvelle Code 11.59 by Audemars Piguet, cette complication ancestrale est associée pour la première fois à la technologie de Supersonnerie. Dévoilée en 2015 dans une montre de la collection Royal Oak Concept, cette innovation développée au terme de huit années de recherche en collaboration avec l’EPFL permet d’allier la performance acoustique d’une montre de poche et l’harmonie des instruments de musique au sein d’une montre-bracelet. Clin d’œil aux chefs-d’œuvre Grande Sonnerie en émail produits à la vallée de Joux aux XVIIIe et XIXe siècles, Audemars Piguet a collaboré pour la première fois avec l’émailleuse suisse Anita Porchet, qui a réalisé une trilogie de cadrans émaillés Grand Feu avec des paillons d’or anciens fabriqués à la main il y a plus d’un siècle.
Autre exemple de l’approche de la manufacture en matière de savoir-faire traditionnel: le nouveau modèle Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon Volant Chronographe Automatique. Contrairement à ce que l’on croit souvent, l’invention dévoilée par Abraham-Louis Breguet en 1801 est demeurée aussi rarissime dans les montres de poche que dans les montres-bracelets du XXe siècle: «Jusqu’au renouveau succédant à la crise du quartz, le tourbillon est pratiquement inexistant dans l’univers des montres-bracelets, rappelle Sébastian Vivas. Les premiers essais sont réalisés dans les années 1930 par les maisons LIP puis Omega pour des concours chronométriques. Patek Philippe leur emboîte le pas avec quelques rares exemplaires jusque dans les années 1960.
Le tourbillon n’est vraiment entré dans l’histoire qu’en 1986, avec le calibre 2870, fabriqué en plus de 400 exemplaires. Il a ouvert une nouvelle voie pour l’horlogerie traditionnelle et imposé Audemars Piguet comme un pionnier des montres-bracelets tourbillon.»


Le mécanisme de chronographe, également présent dans ce modèle, a lui aussi marqué l’histoire de la manufacture. Une plongée dans le premier registre de production tenu par ses fondateurs atteste de la création d’un nombre important de chronographes. Pendant les cinquante-cinq premières années d’Audemars Piguet, cette complication sportive sera essentiellement dévoilée dans des montres de poche avant d’intégrer, pour la première fois en 1930, le boîtier d’une montre-bracelet. Dans les années 1940, ce mécanisme prendra place aux côtés des fonctions calendaires au sein des 20 premières montres-bracelets à doubles complications signées par Audemars Piguet, une autre spécialité de la vallée de Joux.
Des parallèles techniques ou esthétiques comme celui-ci, le patrimoine de la manufacture en regorge. «L’idée n’est pas de copier ce qui a déjà été fait mais d’en avoir une bonne connaissance pour pouvoir continuer à évoluer», analyse Sébastian Vivas, dont les récentes découvertes à propos des montres-bracelets à complications au XXe siècle ouvrent un champ de nouvelles opportunités. Elles invitent à poser un regard contemporain sur l’héritage technique légué par les horlogers de la vallée de Joux.
«Pour chaque nouvelle création, quelque chose nous relie au passé et nous oriente vers l’avenir»
Heureux hasard que celui qui a mené l’équipe du Patrimoine d’Audemars Piguet vers un fond d’archives inconnu. Au terme de quatre ans de recherches, la marque dévoile un pan peu connu de son histoire à travers un ouvrage très pointu intitulé Les montres-bracelets à complications Audemars Piguet au XXe siècle. Interview de Sébastian Vivas, directeur Patrimoine et Musée, co-auteur du livre avec l’historien Michael Friedman.

Vous avez effectué un incroyable travail de recherche dans les archives d’Audemars Piguet pour retracer l’histoire des montres-bracelets à complications. Comment avez-vous procédé?
Tout a commencé par hasard avec la découverte d’un fond d’archives oublié dans un local de la gare du Brassus. En ouvrant les premiers cartons, nous sommes tombés sur quelques dizaines de petits registres cartonnés, contenant des milliers de pages truffées d’informations pour la plupart assez peu lisibles. Il s’est avéré que ces registres décrivaient presque chaque montre terminée par Audemars Piguet jusque dans les années 1950. Jusqu’à cette découverte, nous possédions uniquement des descriptifs des mécanismes horlogers, mais rien concernant les montres finies. Parallèlement, nous avons retrouvé de petites enveloppes contenant des centaines de photos passeport numérotées représentant des montres, mais sans aucune autre référence.
Au final, il nous aura fallu plus de quatre ans pour dépouiller tous ces documents et recouper les photos et les registres. Le livre dédié aux complications est le premier résultat issu de ce fonds documentaire, véritable trésor archivistique. Pour un historien, tomber par hasard sur un tel fonds, ça vaut de l’or!
Votre étude permet de mettre en lumière un aspect plutôt méconnu du patrimoine d’Audemars Piguet. Quels ont été les grands enseignements de vos recherches?
Tout d’abord, la nature même des sources nous a renseigné sur la manière dont travaillaient les horlogers, leur organisation, la petitesse de l’entreprise, les relations avec d’autres ateliers de la vallée de Joux, et bien sûr leurs créations. Nous savions qu’Audemars Piguet avait fabriqué très peu de montres-bracelets à complications, mais nous n’imaginions pas qu’elles étaient aussi peu nombreuses.
En un siècle, à peine 550 montres-bracelets ont été produites! Et parmi elles, seulement 35 répétitions minute! A ce propos, nous avons pu vérifier une hypothèse qui circulait depuis longtemps chez nos historiens: nous avons démontré le rôle des montres féminines dans l’avènement de la montre-bracelet. Plusieurs montres pendentifs miniatures à répétition minute ayant été transformées en montres-bracelets dotées de cette complication.
Un autre enseignement: le tourbillon, que l’on présente aujourd’hui comme l’un des mécanismes les plus sophistiqués, n’a quasiment pas été présent dans la montre-bracelet au XXe siècle. Depuis son invention par Abraham-Louis Breguet, le tourbillon avait essentiellement été utilisé dans le cadre de concours d’observatoires astronomiques. Introduite par Audemars Piguet en 1986, cette complication a participé à la renaissance de l’horlogerie dans le sillage de la première montre automatique à quantième perpétuel, dévoilée par Audemars Piguet en 1978, au plus fort de la crise. Alors que d’aucuns avaient cru à la fin de l’horlogerie suisse, les complications ont permis sa renaissance!
Les montres sont des objets de culture qui s’inscrivent dans la durée. Et c’est en puisant dans son histoire que l’horlogerie a pu se réinventer.
Dans quelle mesure le patrimoine permet-il d’éclairer ou d’inspirer le travail réalisé aujourd’hui par votre marque dans le domaine des montres à complications?
Les collections de montres anciennes et les archives sont des sources d’inspiration incontestables. Les liens de filiation s’expriment au niveau du design et des mécanismes, si bien que pour chaque nouvelle création on peut dire que quelque chose nous relie au passé et nous oriente vers l’avenir.
Néanmoins, cette continuité existe d’abord à travers les artisans, ingénieurs et designers qui chaque jour font évoluer les savoir-faire et les transmettent aux nouvelles générations. Comme toujours, l’humain est au centre. Ne citons que Giulio Papi qui, jeune horloger dans les années 1980, rêvait de faire revivre les complications traditionnelles tout en utilisant les dernières technologies. Aujourd’hui encore, lui et son équipe continuent à faire vivre ce rêve, mettant à profit l’immense puissance de calcul des ordinateurs, et la virtuosité des artisans pour créer les montres du futur.
C’est une spirale futuriste, entièrement portée par ses murs de verre incurvés et drapés d’un treillis en laiton. A l’intérieur de cet ovni architectural réalisé par BIG (Bjarke Ingels Group), les parois de verre incurvées convergent dans le sens des aiguilles d’une montre vers le centre de la spirale, avant de se dérouler dans le sens inverse. On traverse le bâtiment dans un mouvement similaire à celui du ressort spiral d’une montre. Le Musée Atelier inauguré cette année par Audemars Piguet dévoile au grand public la culture horlogère sous toutes ses facettes, dans tout ce que cela suggère de savoir-faire technique et d’héritage esthétique.
Découvrez l'univers du Musée Atelier Audemars Piguet.
Quelque 300 montres historiques et contemporaines y retracent près de deux siècles d’histoire horlogère à la vallée de Joux selon un parcours immersif imaginé par le scénographe allemand Atelier Brückner. Sculptures, automates, installations cinétiques, maquettes de mouvements, mécaniques complexes, tables didactiques et montres d’exception rythment la visite. Au cœur de la spirale se dévoilent les montres à complications historiques et contemporaines de la manufacture. Des montres à calendrier, à sonnerie et à chronographe gravitent autour de L’Universelle, cette montre de poche datant de 1899 dont les 21 complications l’imposent comme la plus compliquée produite à ce jour par Audemars Piguet. L’exposition se termine par une sélection de modèles Royal Oak, Royal Oak Offshore et Royal Oak Concept.


«Nous souhaitions que les visiteurs puissent vivre notre patrimoine, notre savoir-faire, nos origines culturelles et notre ouverture sur le monde, dans un espace qui reflète à la fois nos racines et notre esprit visionnaire, explique Jasmine Audemars, présidente du conseil d’administration. Mais nous voulions avant tout rendre hommage aux horlogers et artisans, qui de génération en génération, ont fait de la manufacture Audemars Piguet ce qu’elle est aujourd’hui.» La nouvelle spirale du musée est donc tout naturellement connectée à la maison des fondateurs. Ce bâtiment historique, datant de 1868, a été entièrement restauré pour accueillir les visiteurs dans un univers de boiseries et de pierres anciennes. C’est là, au dernier étage, où la lumière est la plus abondante, que Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet avaient créé leur atelier en 1875. C’est également dans ce bâtiment que sont conservés les registres et les archives de la manufacture, sous le regard protecteur des équipes du département patrimoine qui partagent les lieux avec la Fondation Audemars Piguet et l’atelier de restauration.